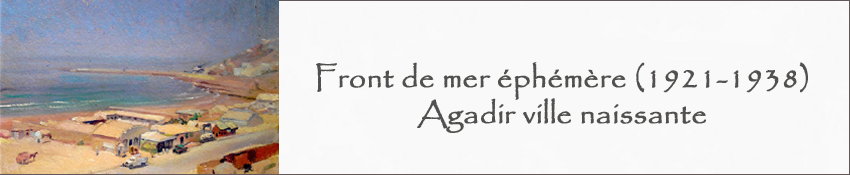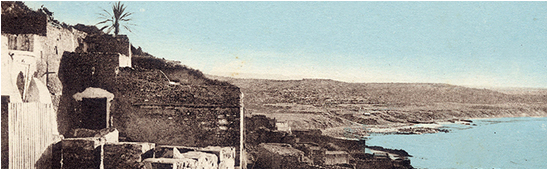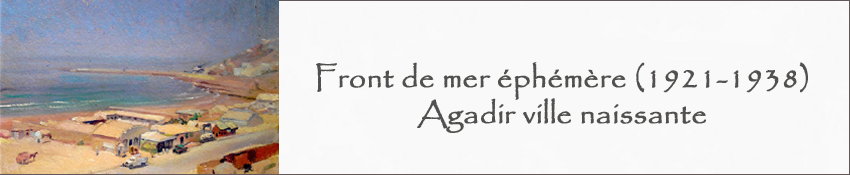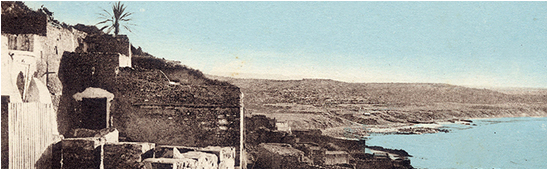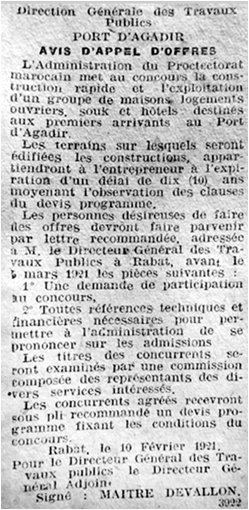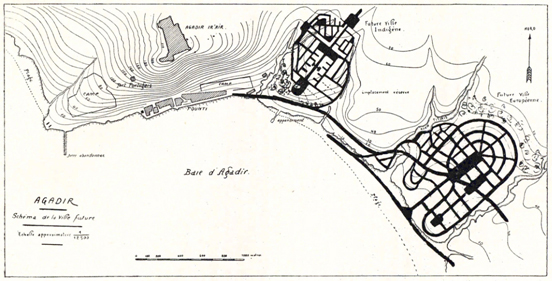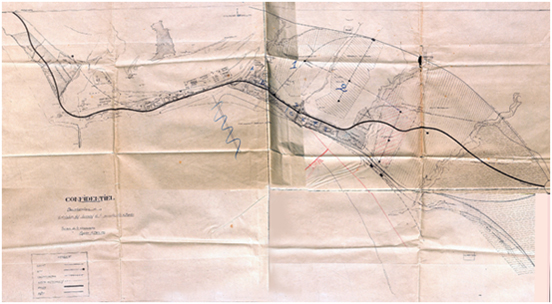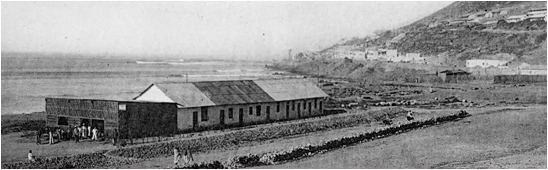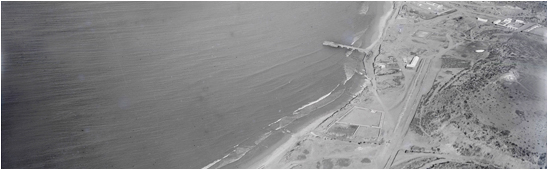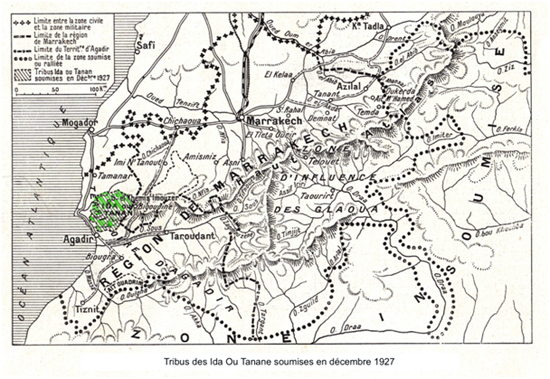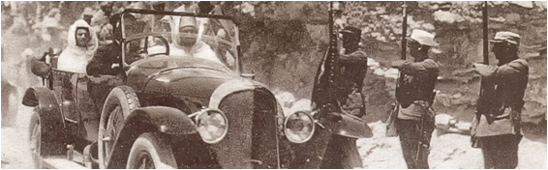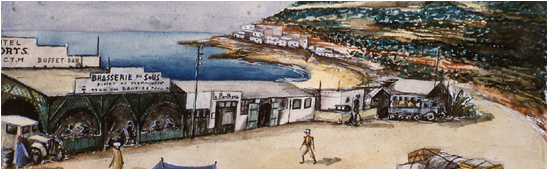Recensement du 8 mars 1931 de la population de la ville d'Agadir
:
3 081 habitants se répartissant ainsi :
Français : 725 (702 citoyens français, 22
sujets français, 1 protégé français)
;
Européens : 123 (32 Espagnols, 41 Italiens, 50
autres nationaux) ;
Indigènes : 2 233 (1967 Musulmans, 266 Israélites
marocains) (Zeys, 229-230).
Militaires : 817
La population avait augmenté de plus d'un tiers en 5 ans.
La population du Souss était évaluée à
300 000 habitants.
1931 et 1932 subirent à nouveau le passage
destructeur des sauterelles.
1932 :
La situation foncière fut rapidement et efficacement apurée
en 1932 grâce à la Commission de Conciliation présidée
par P. Zeys.
Pierre Robitaillie dans un ouvrage qui s'intitulait : "…
Agadir Le Sous … Aperçus d'organisation économique
et rationnelle" (paru en juillet 1932) concernant la
période allant de février à septembre 1931,
écrivait : "Les constructions édifiées
près du port au flanc de la Kasbah, abritent surtout des
bureaux administratifs et militaires. Plus loin sur le Front
de mer, se trouvent le souk, la poste, les baraquements à
usage de comptoir, garages, hôtels, etc." (Robitaillie,
p. 106).
Sur la rive Sud du front
de mer, des constructions
légères, bâties côté mer, représentaient
le commerce et l'industrie à Agadir ; "ce qui caractérise
Agadir, disait-il, c'est l'extraordinaire circulation qui
s'y développe, l'activité qui s'y déploie,
la foule bizarre qui s'y coudoie ; le tout s'apparente avec les
caractéristiques d'une ville embryonnaire du Far-West"
(Robitaillie, 1932, p. 106).