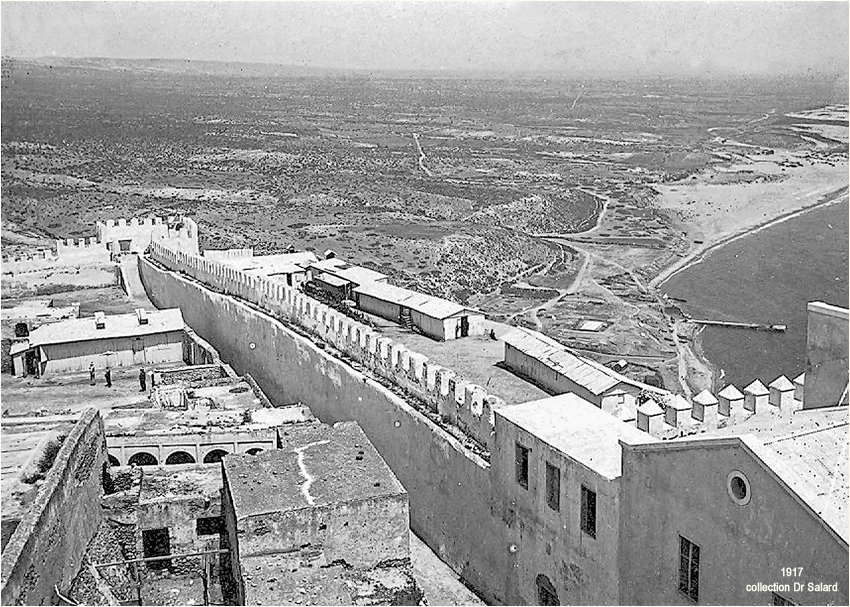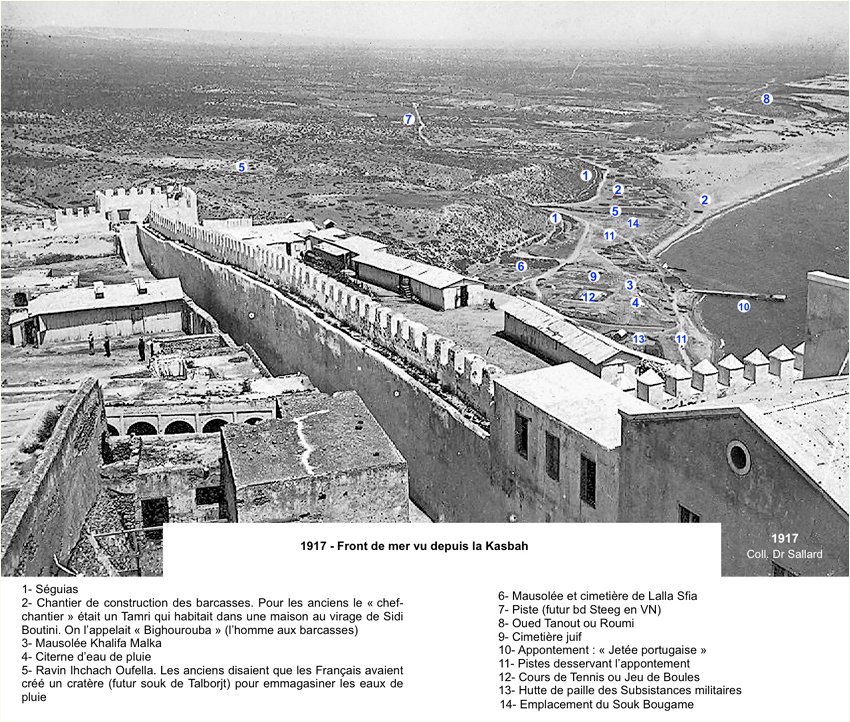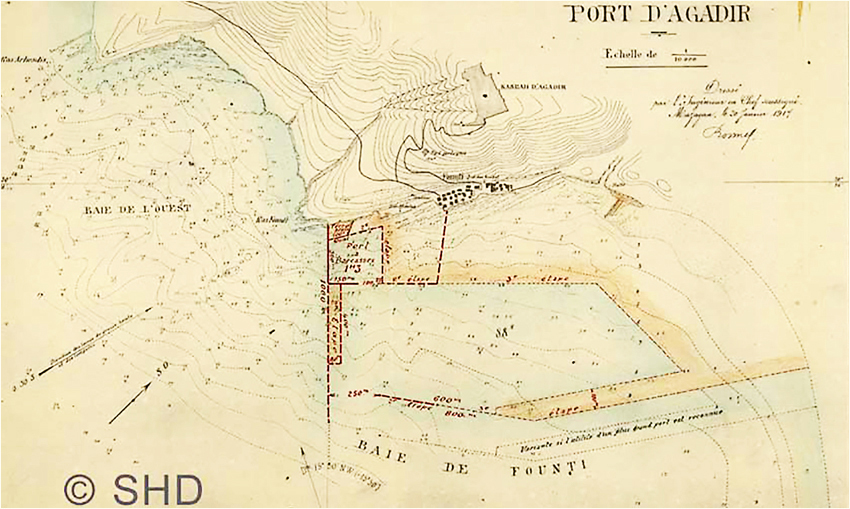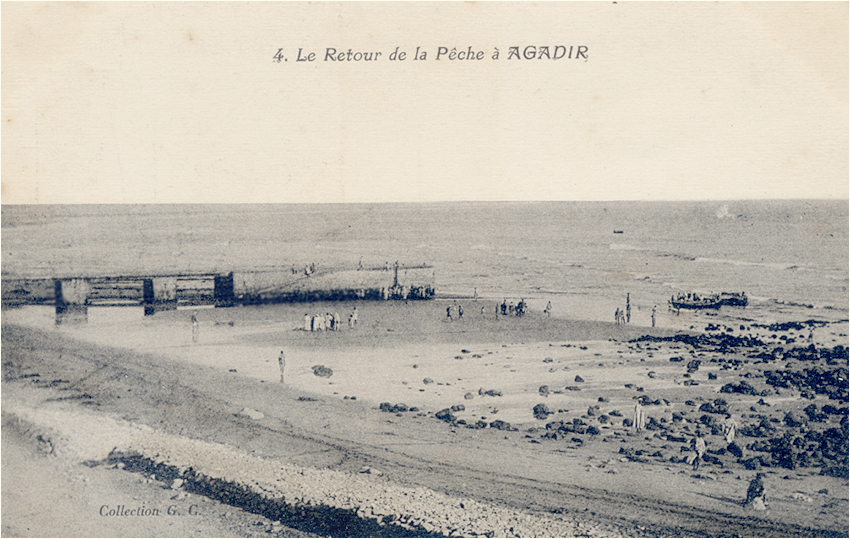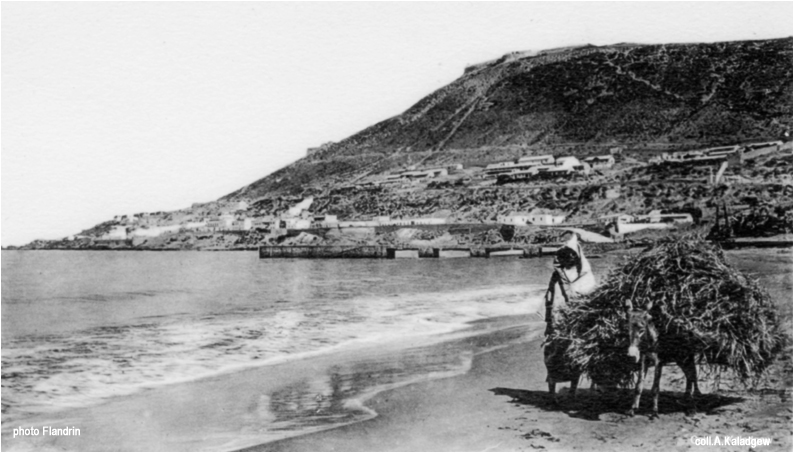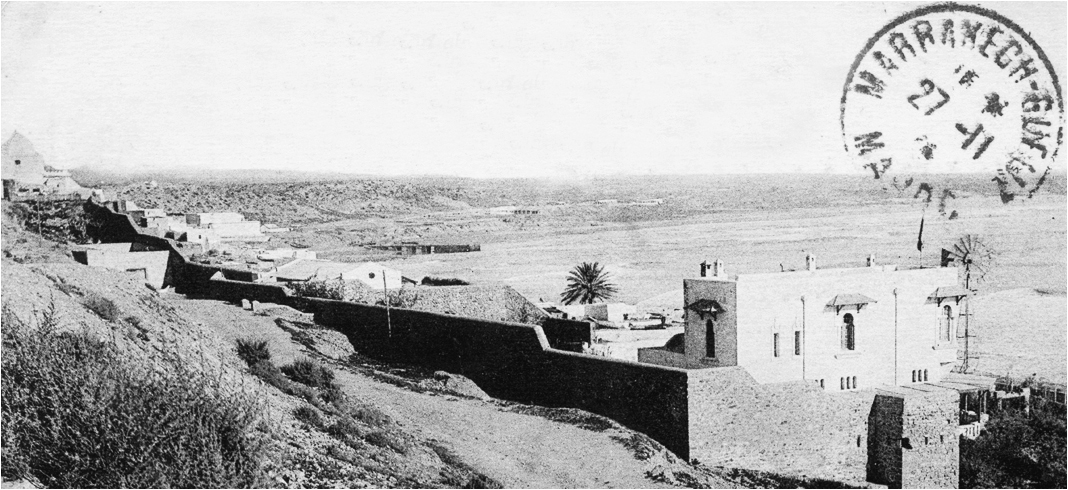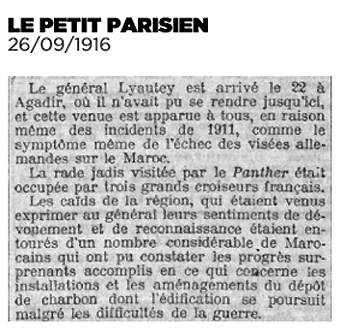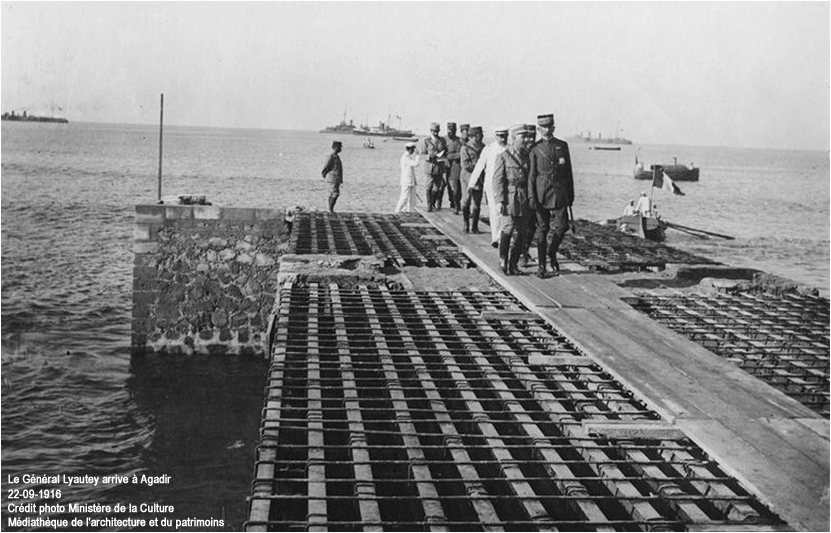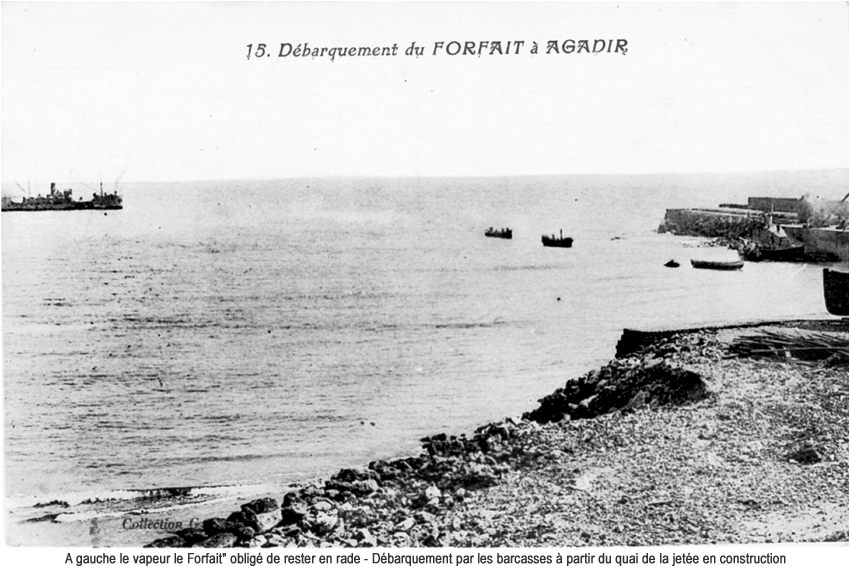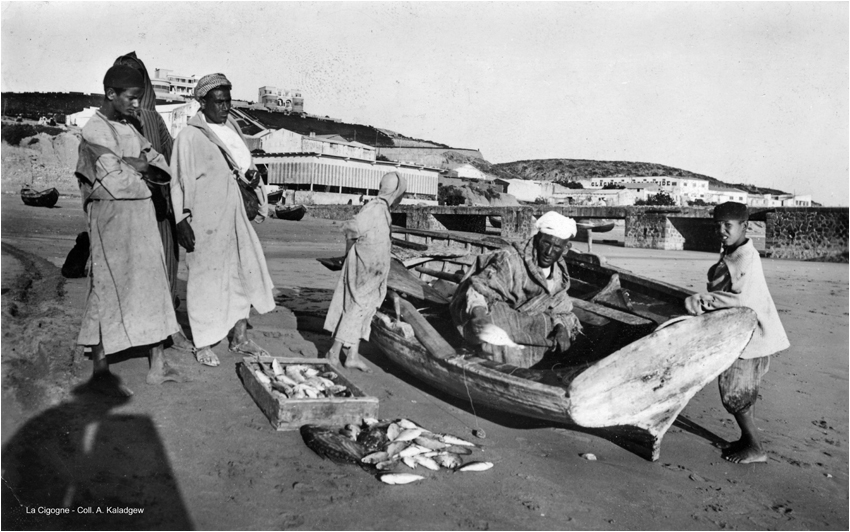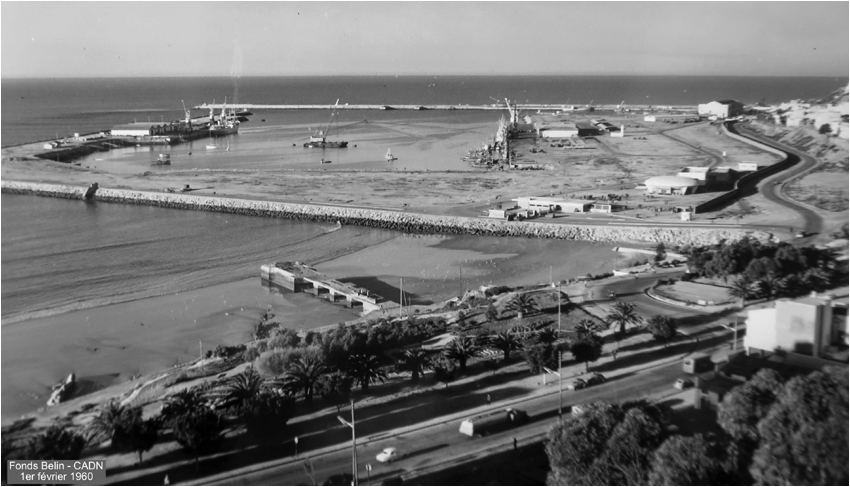La réunion d'une Commission
mixte en vue d'examiner les problèmes que posait l'ouverture
du port au commerce fut décidée (Dépêche
N° 1014 SGP du 11 février 1921, CADN).

Les réunions
de cette commission se déroulèrent à Agadir
les 13, 14 et 15 mars 1921,
sous la présidence M. Maitre-Devallon (directeur
général adjoint des TP)
auxquelles participèrent :
le colonel Freydenberg (commandant le cercle autonome
d'Agadir),
les ingénieurs des Ponts et Chaussées (Picard
et Monat),
Favereau (Chef du Service des Domaines),
des représentants des Douanes, PTT, de l'Enseignement,
du Service d'Architecture, du Service de Santé,
le Secrétariat général du Protectorat,
l'État-Major du Maréchal,
la Marine,
les Services municipaux (représentés par le capitaine
Mondet qui s'était auto-investi de cette fonction
ce qui constituera un incident),
la Direction des Renseignements. |
Le 13 mars 1921, deux sous-commissions furent créées
:
- La 1ère sous-commission, technique, (composée
du directeur-adjoint des Travaux Publics (M. Maitre-Devallon)
et des ingénieurs Monat et Picard) fut chargée
d'examiner les questions de travaux publics et en particulier
de fixer l'emplacement définitif du port ;
- La seconde sous-commission
présidée par le commandant Cavard et comprenant
tous les autres membres de la commission fut chargée de
rechercher le meilleur emplacement de la ville future
et chercher à appliquer sur le terrain le plan dressé
à Rabat par M. Prost (chef de service des Plans de
Villes) suivant les données fournies par la mission
Sanglé.
Le 14 mars 1921 :
- Après s'être rendue sur le terrain, la 1ère
sous-commission estima qu'il y avait lieu d'abandonner l'emplacement
actuel du port et de le reporter près du débarcadère
(appontement) dans la portion de la baie comprise à
l'Est des Subsistances et le ravin de Tildi ;
- En même temps, cette solution déterminait l'emplacement
de la future ville.
|

À
quoi ressemblait Agadir en 1921 :
Au printemps
1921, lors d'un voyage organisé dans le Souss par Prosper
Ricard
(Chef du Service des Arts Indigènes du Maroc (1920-1935)),
le linguiste Émile Laoust (1876 1952) qui se trouvait
en compagnie du capitaine Martel, de MM. Pallary et Sharpe, décrivit
ainsi Agadir : |
"
Le port berbère s'étend au fond de la baie auprès
d'un wharf en construction, non loin d'un cimetière juif
avec de grossières figurations humaines taillées
dans les pierres tombales ".
" Quelques pirogues dépourvues de leurs agrès
sont tirées sur le sable dans un endroit désert.
Quand les pêcheurs ne sont pas en mer, on peut les voir
au village assis à l'ombre de leurs maisons, le long de
la corniche qui domine la baie, surveillant ou raccommodant leurs
filets qui sèchent au soleil " (É. Laoust, Hesperis, p. 244). |
 |
| Le nouveau port
était ainsi constitué de la jetée Nord-Sud
qui n'atteignait en 1921 que 170 mètres de long
et d'un quai de déchargement presque perpendiculaire à
la jetée et au Sud, muni d'une grue à vapeur (J.
Raymond, p. 328). |
La jetée
Nord-Sud avait été construite sur le petit cap
à l'abri des vents du Nord Ouest soufflant toute l'année.
Le port, construit pendant la première guerre mondiale,
rendit de grands services en abritant des vents du large, les
navires et sous-marins et patrouilleurs opérant dans les
parages. |
L'appontement
était maintenant plus ou moins abandonné, envahi
par le sable.
Selon J. Raymond, la construction du port fut arrêtée
pour deux raisons sans compter la période de guerre : |
1. Le port situé
au pied de la colline n'avait pas assez d'espace pour se développer
vers l'arrière ;
2. Le port s'ensablait trop rapidement par ailleurs. |
 |
En 1921,
il était possible d'aller à pied sec à marée
basse jusqu'à hauteur de l'extrémité ouest
de la jetée.
Le quai de débarquement servait à marée
haute à décharger les approvisionnements qui arrivaient
une fois par mois de Casa-
blanca (par le bateau "Forfait").
On pouvait heureusement décharger à Agadir des
navires en toutes saisons, car il n'y avait pas de ressac. Malgré
le vent violent qui soufflait sans cesse, la baie restait calme
et très poissonneuse (bonites, soles, grondins, raies,
mulets, langoustes, etc.). Il n'était pas rare de voir
des chalutiers espagnols et portugais opérer dans la baie.
J. Raymond estimait qu'il n'était pas déraisonnable
de prévoir une pêcherie moderne à Agadir
avec fabrique de conserves et de salaisons et utilisation des
déchets comme engrais (J. Raymond, p. 329.). |
Deux fois par
semaine, un souk se tenait le jeudi et le dimanche à
la sortie Est de Founti sur le front de mer (J. Raymond,
p. 331) à proximité de l'appontement.
On y trouvait de la viande, des poulets, des œufs, du beurre,
du poisson, des fruits et des légumes en petite quantité.
Les militaires étaient ravitaillés par l'administration
militaire.
Il existait une coopérative militaire bien achalandée
où tous les Européens civils pouvaient se fournir
"à quelques centaines de mètres du douar
réservé, vaste enceinte basse contenant une
série de niches immondes où une cinquantaine de
filles se livraient à la prostitution ". |
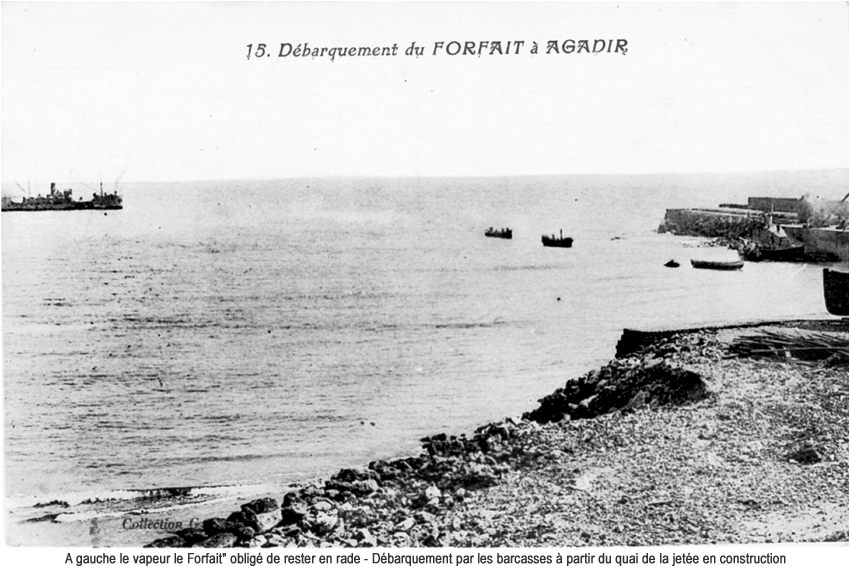
|