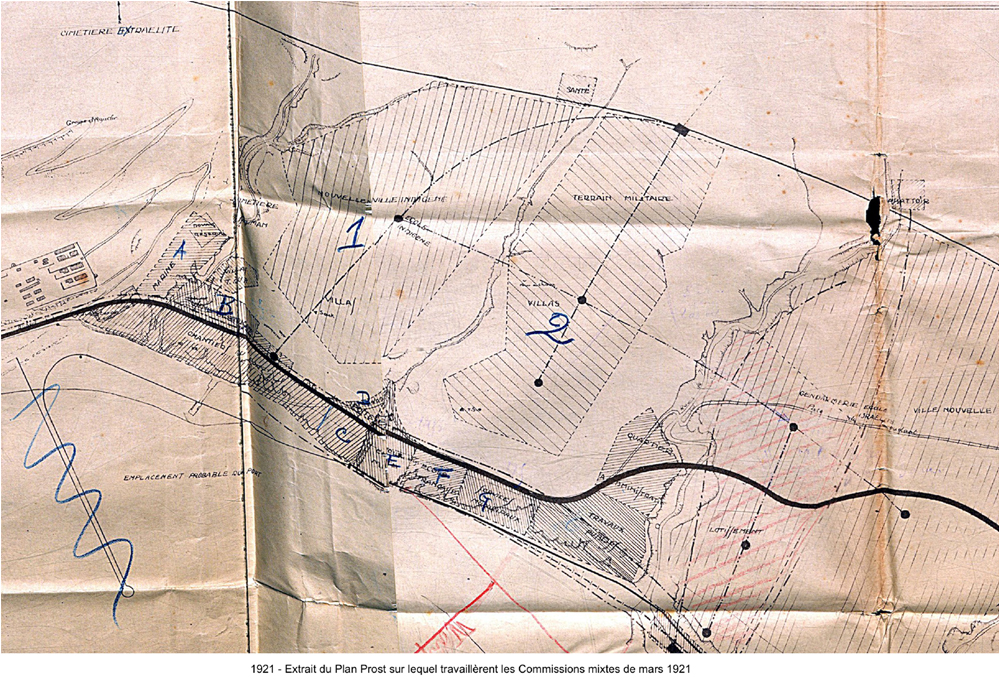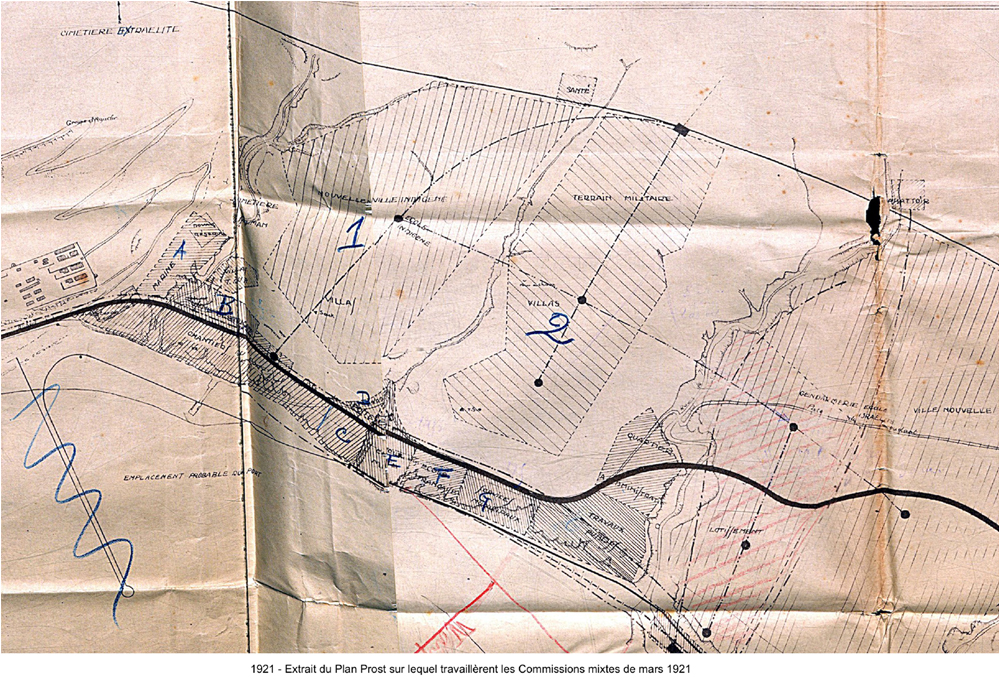La
situation juridique des terrains à Agadir fut alors exposée à
la Commission par M. Favereau (Chef du Service des Domaines).
Tout le périmètre dans lequel se trouvait englobé
Agadir et ses environs était en principe (sic) Makhzen.
En ville pouvaient exister : ou bien des immeubles Makhzen,
melk, ou bien des immeubles dont l'asel (nue-propriété)
était Makhzen mais dont la zina (propriété
des constructions) appartenait aux occupants. En dehors de la
ville n'existaient que des terrains Makhzen, occupés
à titre guich par les tribus environnantes. Ce
n'était là qu'un principe général
: il était possible qu'il y eût des biens ruraux
habous ou melk dont le caractère était
établi par des titres réguliers.
Le seul moyen d'apurer définitivement la situation
juridique des terrains d'Agadir était la procédure
de délimitation du domaine de l'État prévue
par le dahir du 3 janvier 1916.
Cette procédure
relativement rapide ne pourrait être engagée
qu'après l'ouverture d'Agadir.
Or il était indispensable que le lotissement de la ville
nouvelle soit prêt avant l'ouverture afin que les premiers
arrivants trouvent immédiatement de quoi s'installer.
Il était possible dans ces conditions que les terrains
choisis par la Commission pour l'emplacement de la ville nouvelle
fassent l'objet de revendications qui ne seront connues que lorsqu'elles
seront révélées par la voie de l'opposition
à la procédure de délimitation.
Ceci ne devrait pas être un obstacle, il était nécessaire
d'agir comme si les terrains étaient libres ; le Domaine
réglerait plus tard les litiges (Commission, p. 19,
CADN).
En ce qui concernait
l'emplacement de la ville nouvelle, cet emplacement était
constitué par des terres non cultivées que leur
nature rocheuse rendait impropre à la culture. Il s'agissait
des terres "mahroum" dont la propriété
en droit musulman appartenait à l'État.
Il fut proposé que le capitaine, Chef du bureau local
des Renseignements, fasse établir un acte de notoriété
attestant que le périmètre dont les limites étaient
celles de la ville nouvelle, appartenait à l'État
en tant que mahroum et n'avait jamais fait l'objet d'appropriation
privative.
La délimitation proprement dite en la forme du dahir de
1916 portant sur tous les terrains d'Agadir, ne pourra se faire
qu'après l'ouverture de la ville. En attendant, le cadi
devra refuser catégoriquement toutes autorisations quelles
qu'elles soient d'acte constitutif, déclaratif ou translatif
de propriété portant sur les terrains d'Agadir.
La Direction Générale des TP devra prendre un dahir
d'utilité publique concernant le port et les installations
annexes, les voies de communication y compris la voierie, le
chemin de fer, l'adduction d'eau, les égouts, l'installation
des services publics, l'hôpital et toutes les installations
d'utilité publique.
Ce dahir déclaratif d'utilité publique portera
la réserve d'une large zone de servitude.
L'autorité militaire prendra de son côté
en ce qui concerne le terrain d'installation qu'elle aura choisi,
toutes les mesures qu'elle jugera opportune.
|