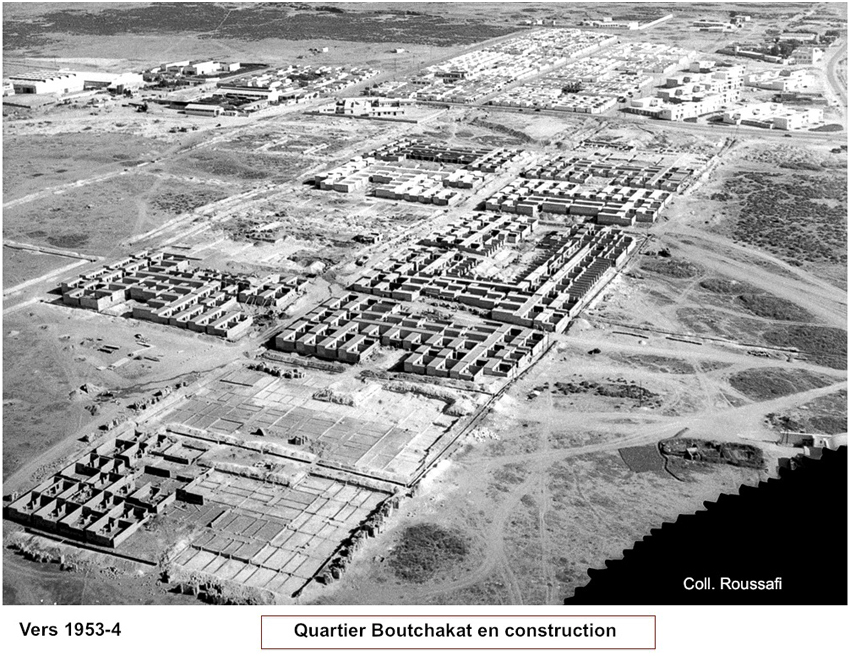Pendant la guerre de 1939-40, l'industrie de salaisons commença
à se développer à Agadir avec un petit quartier
industriel constitué à Anza au nord-ouest
d'Agadir.
Mais ce quartier, très étroit, offrait des inconvénients
: il était limité entre la route et la mer, il
ne pouvait être étendu, la pente étant trop
forte et les embruns trop importants pour l'industrie de la conserve.
Pour ces raisons, la municipalité envisagea la mise en
place d'une autre zone à l'est de la ville, zone
bien dégagée, sur un plateau en pente douce permettant
toutes les extensions ultérieures mais présentant
cependant l'inconvénient d'être à 4,5
km du port.
Les avantages de cette situation l'emportèrent et l'emplacement
du Quartier Industriel fut choisi à l'est de la ville.
Le zoning tracé par Henri Prost dans les années
20 fut maintenu par Michel Écochard, directeur
du Service de l'Urbanisme fin des années 40, promoteur
de la Charte d'Athènes et du principe de l'Habitat social
adapté au plus grand nombre.
Le service de l'Urbanisme reprit le plan du Quartier Industriel
afin de simplifier les parcelles en les rendant orthogonales,
pour faciliter le raccordement ferré en cas de création
d'un chemin de fer à Agadir.
Les zones d'habitat ouvrier dispersées à
l'intérieur du QI furent regroupées dans la
partie sud de celui-ci, en liaison directe avec les industries
et pouvant s'étendre au besoin.
À partir de 1949, les usines de
conserve (usines de traitement de
poisson et de légumes) construites à un rythme
effréné (une cinquantaine en 1949-50) durent faire
face à une pénurie de main d'œuvre.
Les entreprises firent appel à du personnel féminin
provenant de régions de plus en plus éloignées
d'Agadir et les déplacements en camions pour aller chercher
les ouvrières dans les douars ne permettaient pas de répondre
rapidement aux besoins des usines.
En 1951, deux douars de 320 et 140 tentes furent
constitués aux abords de la ville.
Certains entrepreneurs furent sensibles au problème du
logement et participèrent à la mise en place d'habitations
ainsi Carnaud et Forges de Basse-Indre. Fernand Barutel
à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie
aurait "exigé" des conserveurs qu'ils
financent des cités pour loger la main d'œuvre qu'ils
réclamaient à corps et à cris. Des conserveurs
constituèrent des petites médinas archi-minuscules
dans l'enceinte des conserveries.
C'est dans ce contexte qu'intervint à Agadir, Michel Écochard
directeur de l'Urbanisme, bien décidé à
mener une politique de logement social de grande envergure.
Il s'agissait de favoriser l'habitat des catégories
sociales peu favorisées pour éliminer les bidonvilles
en voie de constitution et reloger les habitants des quartiers
surpeuplés du Port, de Founti, de la Kasbah, de Yachech
et des fermes environnantes.
À Agadir, la municipalité possédait plus
du tiers des terrains du Quartier Industriel. Après
avoir réalisé l'équipement par tranches
sur son budget ordinaire, elle put revendre ces terrains à
un prix qui fixa celui des autres terrains appartenant à
des particuliers, en évitant ainsi la spéculation.
Les décideurs optèrent pour le principe de la séparation
stricte de l'habitat et de l'industrie. Il s'agissait de
protéger les populations des odeurs et fumées
apportées par le vent, et d'établir des liaisons
faciles et rapides entre le QI, les zones de résidence
et les centres de trafic.
Les plans des QI furent entérinés par dahirs,
pris à la diligence de la Direction de l'Intérieur
(Service de l'Urbanisme).
|