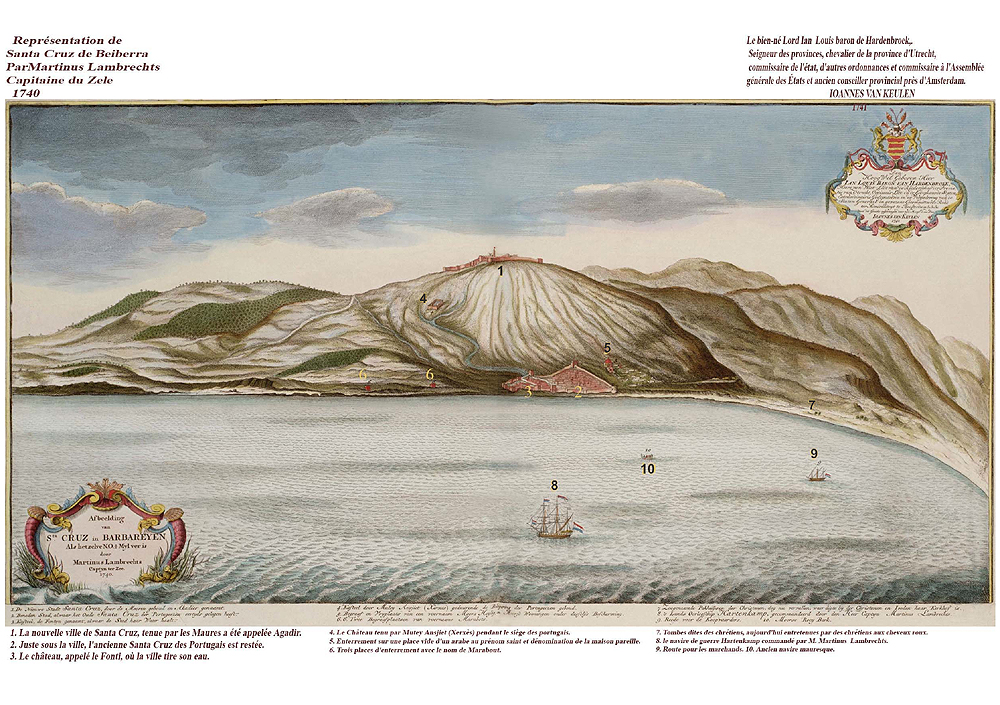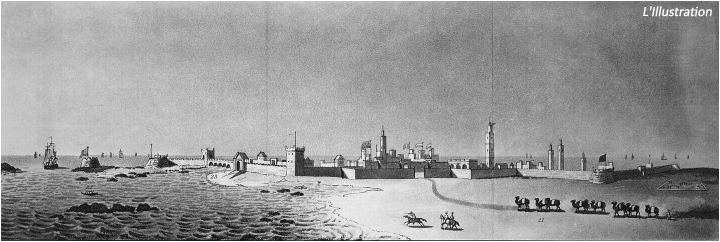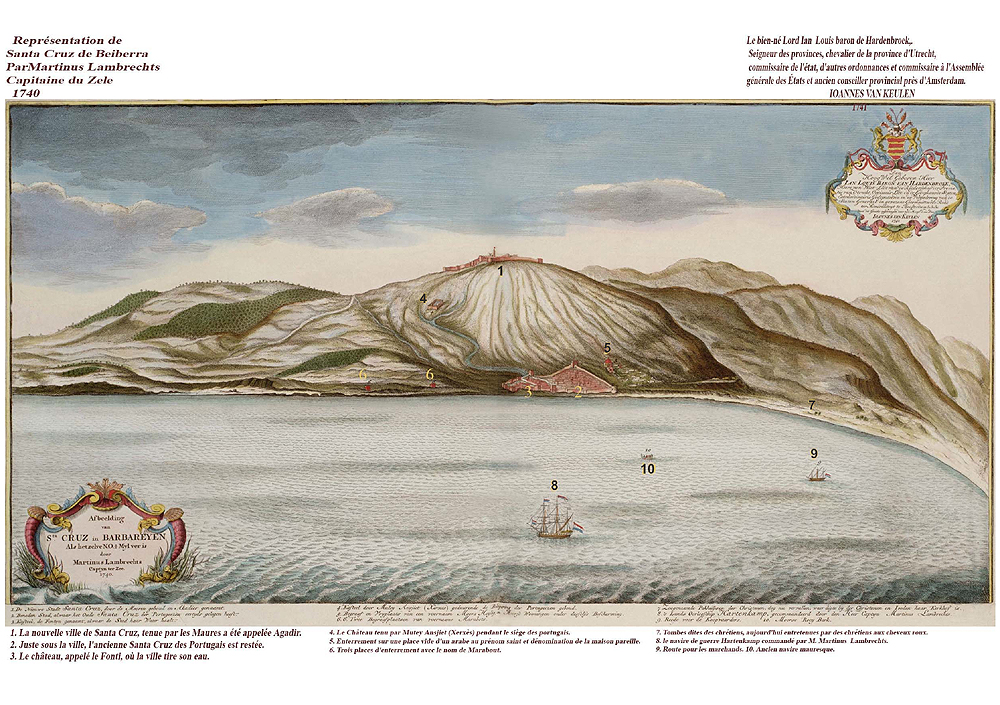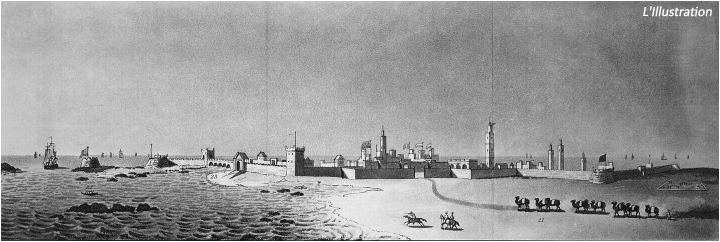| En
1670, Moulay Er Rachid marcha sur Iligh, capitale
du Tazerwalt ; Agadir lui ouvrit ses portes mais ne tarda pas
à retrouver son indépendance (D. Jacques Meunié,
T II, p. 760). |
 |
| Agadir aurait connu un
bon développement sous le règne du grand sultan
alaouite Moulay Ismaïl (1672-1727) devenant un important
centre de commerce caravanier avec le Soudan, connu sous le nom
de "Bab Es Soudan". Selon l'explorateur Oskar
Lenz, toutes les caravanes s'y rendaient (O. Lenz, I, pp. 366-7). |
 |
| Mais à la mort du
sultan Moulay Ismaïl en 1727, l'anarchie s'installa dans
le Souss en particulier sous le sultan Moulay Abdallah (plusieurs
fois proclamé puis renversé) jusqu'à la
nomination de son fils Sidi Mohamed comme gouverneur du
Souss. |
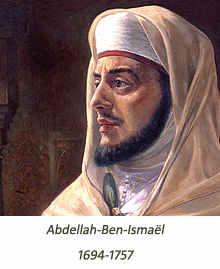 |

Séismes de 1731 et de 1755
Agadir aurait subi un séisme en 1731 ("Von
Hoff écrit : 1731 - Ein Erdheben verwüstet die
Stadt Sainte-Croix in Marocco" : Un tremblement de terre
détruit la ville de Sainte-Croix au Maroc) (D'après
Verneur, Journal de Voyage, t. XV, p. 50) ; Le commandant
Roux (1934) identifie Sainte-Croix à Santa-Cruz d'Agadir
(Cité par J.-P. Rothé, Séisme d'Agadir
et séismicité du Maroc, 1962, p. 18).
On peut constater que le nom de Sainte-Croix persiste encore
dans les écrits européens.
La Kasbah d'Agadir Ouflla aurait été restaurée
ou reconstruite en 1732.
En 1755, le grand tremblement de terre qui détruisit
Lisbonne aurait affecté le Maroc et Agadir à nouveau
(Rothé, La séismicité au Maroc, p.
20, 1962).
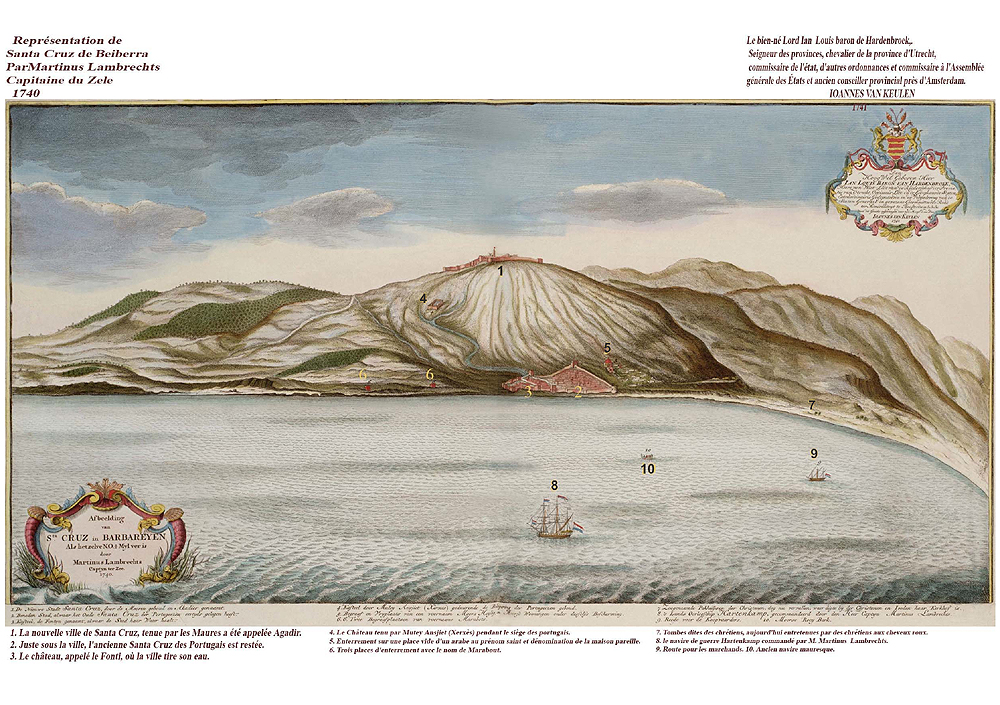

Gérance du port d'Agadir
La plupart des ports du Maroc étaient
mis en gérance par les sultans. Les Juifs qui jouaient
un rôle prépondérant dans le commerce prenaient
à ferme ou à rente les droits des souverains dans
les ports.
En 1762, on apprend par Georg Høst qui fut vice-consul
danois à Souira, que "le juif Ben Isso"
tenait en gérance le port d'Agadir, pour lequel il était
redevable d'une somme de 20 000 piastres.
Connaissant bien ce Juif, le sultan Mohamed Ben Abdallah le fit
venir devant lui et lui aurait dit :
"Toi, le truand, tu vas recevoir la peine que tu mérites,
non pas à cause de l'argent que tu me dois personnellement
- tes frères (les autre Juifs) me le paieront jusqu'au
dernier sou - mais pour ce que, toute ta vie durant, tu as truandé
tant chez les Maures que chez les Chrétiens, et même
chez les autres Juifs" ; "Et il lui fit couper les
deux mains" (G. Høst, p. 62).
Par ailleurs, le nommé
Taleb Salah Ben Daoud El Mejjatti se serait rendu indépendant,
propriétaire de nombreuses terres irriguées et
habousées avec Agadir comme capitale. Il percevait des
droits sur les bateaux étrangers et des redevances sur
les caravanes.
Le sultan aurait résolu de le soumettre et vint camper
avec sa mehalla chez les Haha Aït Tameur. Moulay Mohamed
ben Abdallah aidé des Ksima du Cheikh El Hadj El Hassan
Ben Ali put se porter au lieu dit Boggam au pied de la
forteresse d'Agadir. La place se serait rendue après quelques
jours de siège et Taleb Salah aurait été
pris vivant et condamné à la torture. Il aurait
réussi à se donner la mort.
Parmi ses descendants, se trouverait le Cheikh Mohamed Ben
El Hassan Amjott (1927, Rapport Boniface, p. 7-8) |
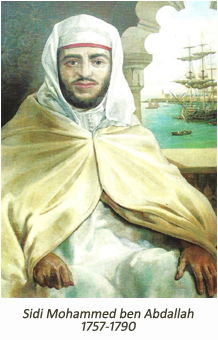 |
.

Création de Mogador (Essaouira,
Tassourt) - Déclin et fermeture d'Agadir (1765-1776)
En 1764-5, le sultan Sidi Mohamed
ben Abdallah (1757-1790) décida de créer le
port d'Essaouira (Mogador) en un lieu autrefois occupé
par les Portugais, pour s'assurer et contrôler le monopole
du commerce maritime et mettre un terme à l'insoumission
des tribus du Souss qui menaçaient la sécurité
de l'empire.
En conséquence, le port de Massa sera détruit
et celui d'Agadir fermé en 1765 puis définitivement
interdit aux navires étrangers en 1776.
Les habitants d'Agadir durent quitter la ville et s'installer
à Essaouira où un quartier "Derb Ahl Agadir"
leur fut attribué. Des négociants juifs furent
encouragés à venir s'installer à Souira
(Tassourt), logés à l'intérieur de la Kasbah.
Les familles juives commerçantes Aflalo, Pena, Guedala
(familles de Tujjar Es Soltan) quittèrent Agadir.
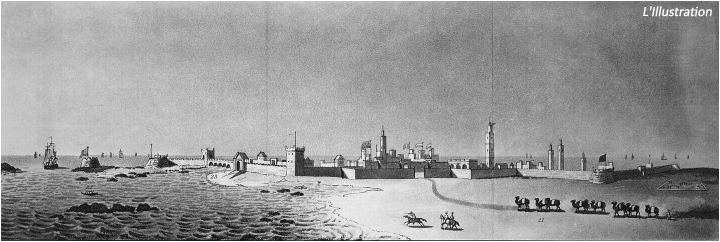
Le consul de France à Mogador, Louis Chénier, confirmera
que la place d'Agadir fut pendant longtemps le centre d'un grand
commerce jusqu'en 1773 ; les nations de l'Europe y avaient plusieurs
établissements que l'empereur fit passer à Mogador,
"après avoir fait démolir les fortifications
de cette ville".
À partir de
cette date, le mouillage d'Agadir ne sera plus guère fréquenté
et la ville sera quasiment ruinée
(D. Jacques-Meunié, II, 555).
Les voyageurs qui traversaient le Souss et passaient devant Agadir,
s'étonneront de cette situation déplorable ; en
1789, le chirurgien anglais William Lempriere appelé
à Taroudant pour soigner le fils du sultan Sidi Mohamed
Ben Abdallah, put observer que la place d'Agadir était
déserte ; Il s'étonna qu'on n'ait pas continué
à donner la préférence à cette place
pour toutes les spéculations de commerce (W. Lempriere,
1791, Voyage dans l'Empire du Maroc et le Royaume de Fez fait
pendant les années 1790 et 1791). Dans la traduction
française de cet ouvrage sous le titre : "Le Maroc
il y a 100 ans" figure une gravure de Peter Haas représentant
la Kasbah d'Agadir Ouflla et Founti (Santa Cruz) qu'on retrouve
dans l'ouvrage de Georg Höst, vice-consul danois à
Mogador (Efterretninger om Marokos og Fes (1760-1768).

En 1880, l'explorateur
Oskar Lenz séjournant dans le Souss, constata à
son tour que le port d'Agadir était le meilleur des ports
marocains ; cependant, il était vide et abandonné.
La ville était en complète décadence ; elle
ne comptait que quelques centaines d'habitants, tous Maures,
à l'exception de quelques familles juives. Agadir située
sur un rocher de plus de 200 mètres d'altitude constituait
une forteresse naturelle en outre fortifiée par des murailles
et des batteries
(O. Lenz, I, p. 366). |
 |
| En 1882, deux
ans plus tard, l'officier Jules Erckmann, instructeur
et chef de la mission française au Maroc (1878-1883) pour
le compte du sultan Hassan I (1873-1894), constatait que
les murs de la forteresse d'Agadir étaient en bon état
mais les chemins qui y aboutissaient étaient difficiles
et tortueux. Celui qui passait à l'Est longeait le mur
d'enceinte à un endroit où il n'y avait guère
que deux mètres de hauteur, ce qui permettait aux voleurs
de l'escalader ; du côté de la mer, on voyait un
misérable village de pêcheurs appelé Founti. |
 |
La place d'Agadir étant le meilleur mouillage de l'océan
depuis le cap Spartel jusqu'au cap Juby, la ville aurait dû
s'étendre, mais il n'en fut rien : après la fondation
de Mogador (Essaouira), elle fut fermée au commerce européen
et ses relations avec l'Europe cessèrent à peu
près complètement (J.
Erckmann, pp. 50-51).
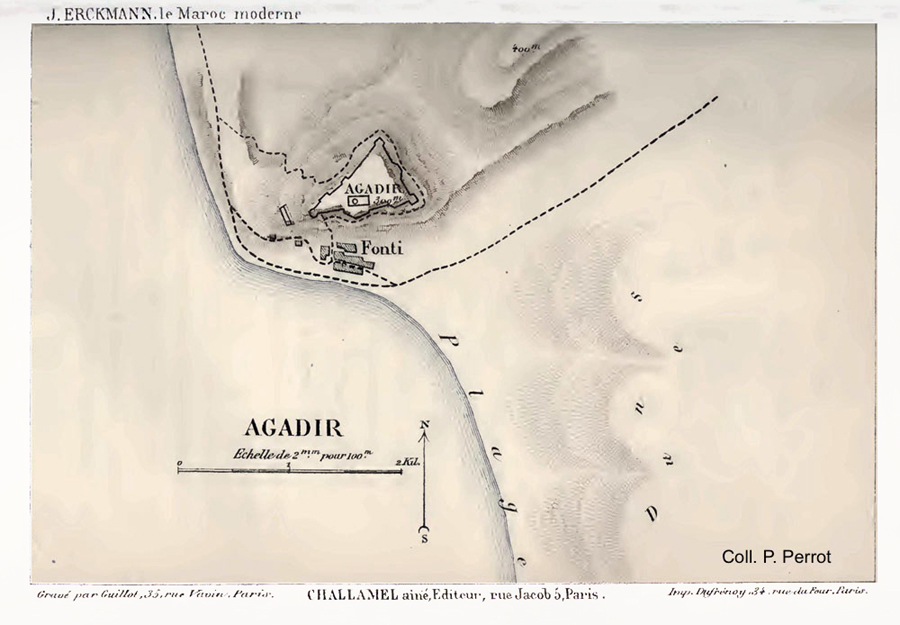
Les grandes puissances s'intéressaient
particulièrement au Maroc et parmi elles les Français
(installés en Algérie) et les Allemands ; la région
du Souss était réputée pour sa richesse,
les Français et les Allemands en rivalité essayaient
de s'implanter en achetant des terrains et en effectuant toutes
sortes de recherches.

Coup d'Agadir (1er juillet 1911-
28 novembre 1911)
|
Après l'occupation de Fès
par les Français au printemps 1911, l'ambassadeur d'Allemagne
M. de Schoen fit savoir au gouvernement français que l'Allemagne,
très mécontente, avait décidé d'envoyer
un bâtiment de guerre dans la rade d'Agadir afin de protéger
les intérêts de ses ressortissants dans le Souss
et affirmer ses prétentions dans la région.
La canonnière allemande "Panther" fut
envoyée en rade d'Agadir. Le "coup d'Agadir"
déclencha une crise internationale d'une extrême
gravité.
La canonnière "Panther" fut remplacée
par le "Berlin" le 6 juillet et par l'"Eber"
pour assurer le ravitaillement des Allemands depuis les Canaries
jusqu'au 28 novembre.
|
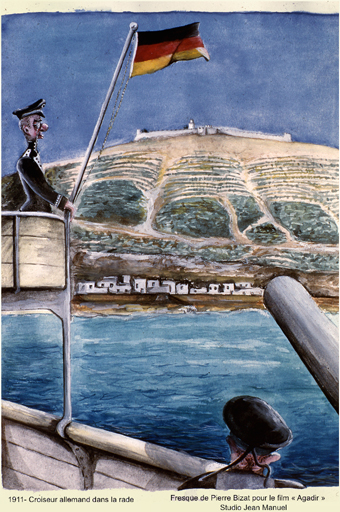 |
Une certaine effervescence régnait à Founti et
à la Kasbah où se trouvaient réunis les
journalistes Georges Mercier et Hubert Jacques, l'ingénieur
Gustave Evesque et Antoine Fleury de l'Union des Mines Marocaines,
Léon Corcos, grand commerçant de Mogador et correspondant
de la Vigie marocaine, les époux Leroux dépêchés
à Agadir par la Délégation de France à
Tanger et par M. Morizet sénateur et son épouse
en voyage au Maroc.

Un incident se produisit quand les Allemands hissèrent
leur couleurs sur les navires, les Français hissèrent
les leurs à la Kasbah ; le consul de France à Mogador
dut intervenir pour faire cesser ces manifestations.
Finalement, un accord fut négocié et signé
le 4 novembre 1911 entre la France et l'Allemagne qui laissait
à la France les mains libres au Maroc en échange
de territoires au Congo qu'elle concédait à l'Allemagne.

Protectorat français sur
le Maroc (1912-1956)
Le traité franco-marocain
conclu à Fès le 30 mars 1912 entre la République
française et le sultan Moulay Hafid instaura le
Protectorat français dans l'Empire chérifien.
Cependant dans le Souss, la situation n'était pas acquise
aux Français ; la résistance prenait de l'ampleur. |
 |
El Hiba dans le Sud marocain
Avant l'occupation française, les caïds des Ida
Ou Guelloul (Haha) avaient à Agadir un khalifa qui
prenait le titre de pacha.
Lorsque le prétendant El Hiba (d'origine saharienne,
fils du grand marabout Ma El Aïnin) autoproclamé
sultan à Tiznit, quitta cette ville (1912) pour se faire
proclamer à Marrakech, il plaça un khalifa de ses
proches, son cousin et beau-frère Cheikh Sidi Ahmed
(N'Ahmed) à la Kasbah d'Agadir.
El Hiba projetait de parvenir au Haouz en passant par le territoire
de ses partisans Ida ou Guelloul ; il préféra prendre
le chemin d'Ameskroud (dans le territoire des Ida Ou Tanan) pour
ne pas s'exposer aux tirs des croiseurs français.
Agadir fut bombardée par le "Cosmao"
(en particulier la nzala de Tanout ou Roumi, le vendredi
19 juillet 1912) puis durant deux jours consécutifs (7
et 8 août 1912) sur la citadelle où se trouvaient
les partisans hibistes (R. Agrour, p.128-136).
La mosquée de la Kasbah fut atteinte, son minaret
détruit en août 1912. Les habitants d'Agadir prirent
la fuite ; les partisans hibistes des Ida Ou Tanan et des Ida
Ou Guelloul s'installèrent dans la Kasbah. El Hiba aurait
envoyé un contingent de 400 cavaliers pour empêcher
tout débarquement à Founti (R. Agrour, p. 128).
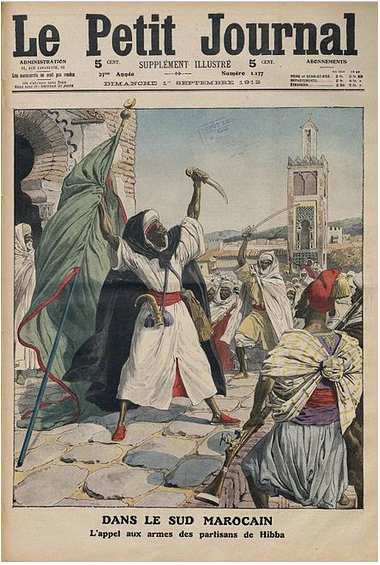 |
Moulay Hmed Hiba fut proclamé
sultan à Marrakech le 15 août 1912 (R. Agrour, p. 138) mais fut défait militairement
à Sidi Bou Othman le 6 septembre 1912 et se réfugia
à Taroudant.
Cheikh Sidi Hmed (khalifa d'El Hiba à Agadir) et
les partisans hibistes Mesguina et Ida Ou Tanane tenaient encore
la Kasbah d'Agadir.
Cheikh Sidi Hmed avait installé pour son compte une nzala
(droits de porte) au Fondouk de Sidi Boulknadel (R. Agrour)
; les Ida Ou Tanane en contrôlaient trois autres sur la
côte dont une à Aghroud, les Imesguine (Mesguina)
une à Tamghart, les Aksimen (Ksima) celle de Founti
(R. Agrour, p. 160). Les gens du Souss se plaignaient des exactions
des partisans hibistes qui accompagnaient El Hiba (R. Agrour
(p. 160-1).
Après la défaite de Sidi Othman, le caïd
El Hadj Lhassen Ou Fkir des Guellouli (ex-allié d'El
Hiba) fit sa soumission au Makhzen et les Ida Ou Guelloul projetèrent
de reprendre Agadir.
À la suite d'une querelle survenue au sujet du partage
des nzalas, les Ida Ou Guelloul battirent les Ida Ou Tanane à
Taghazout (mars 1913) où ils établirent
un poste qui devait leur servir de point de départ pour
atteindre Agadir.
|
Tandis que les grandes harkas se constituaient
pour chasser El Hiba de Taroudant (avril 1913), les Ida Ou Guelloul
reprirent la marche en avant vers Agadir. Pendant la nuit du
23 au 24 mai 1913, ils s'emparèrent de Founti par surprise,
mais en furent chassés les jours suivants.
Les Ida Ou Guelloul se
replièrent sur Tamraght et demandèrent l'appui
d'un croiseur français ; le "Du Chayla"
fut envoyé. Il entra en relation avec la harka du Guellouli
et la protégea par le feu de ses canons.
Le 31 mai, cette harka commandée par le caïd Makhzen
Lahsen Oufkir des Haha, put atteindre Agadir convoyée
par le croiseur et s'empara le même jour de la forteresse.
Le khalifa d'El Hiba fut chassé par le caïd des Haha
ainsi que les partisans Mesguina et Ida Ou Tanane. La harka Guellouli
s'installa sous la protection du "Du Chayla" mouillé
en rade.
Le 6 juin 1913, les officiers du "Du Chayla" seraient
descendus à terre, fêtés par les habitants.
Cependant El Hadj Abderrahman Guellouli aurait été
gravement blessé et soigné à bord du "Du
Chayla". |
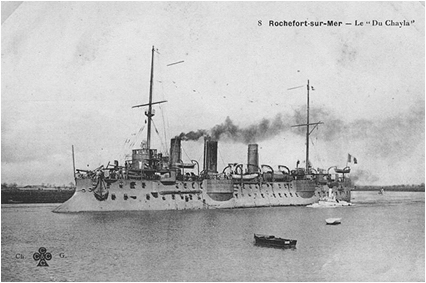 |
Le résident général Lyautey
qui avait refusé jusque-là d'occuper Agadir, point
d'appui important dans le Souss pour sa conquête, mais
impossible à tenir sans avoir les forces militaires nécessaires.
Cette fois l'occasion parut trop belle aux Français pour
que l'occupation d'Agadir soit remise à plus tard.

Occupation française d'Agadir
: 14 juin 1913
La garnison du poste d'Agadir fut embarquée le 13 juin
1913 à Mogador et débarquée le lendemain
matin 14 juin sur la plage de Founti.
La prise d'Agadir complétait l'entrée dans Taroudant
des harkas Glaoua et Goundafa (23 mai 1913).
El Hadj Abderrahman Ben Mohamed El Guellouli représentant le caïd des Ida Ou Guelloul
fut nommé pacha d'Agadir par Dahir chérifien
en date du 4 Choual 1331 (6 septembre 1913) (CADN, Occupation
du Poste d'Agadir, Marrakech 14 juin 1913, S-A R G-28 juin
1917).


|