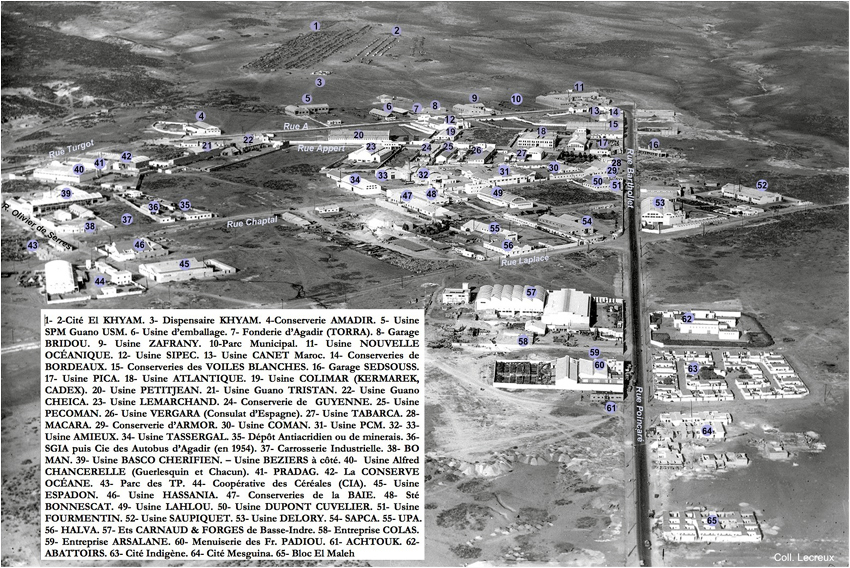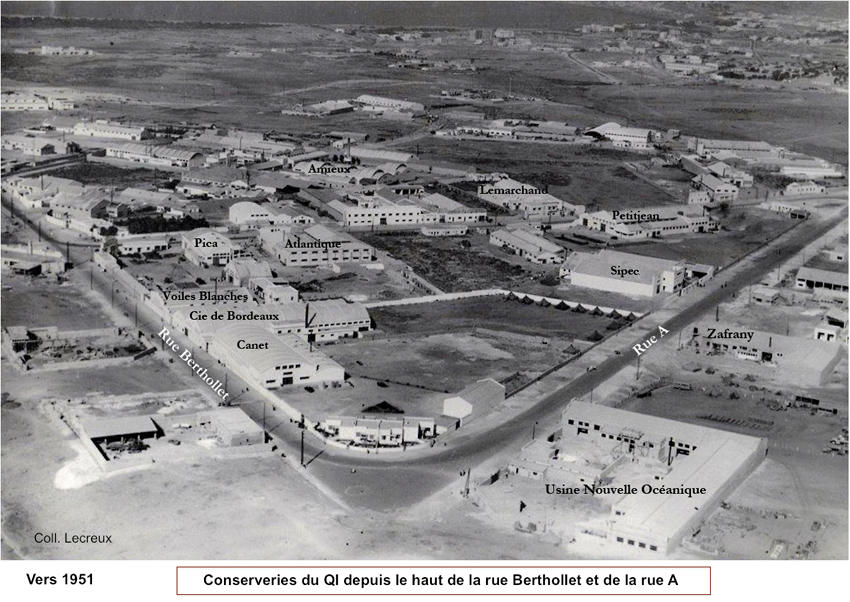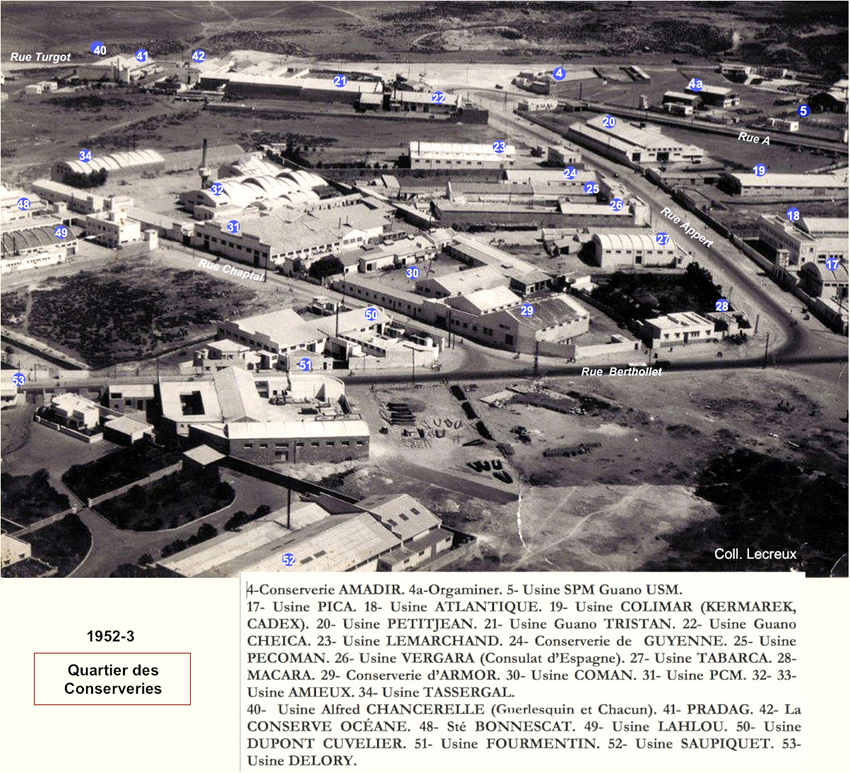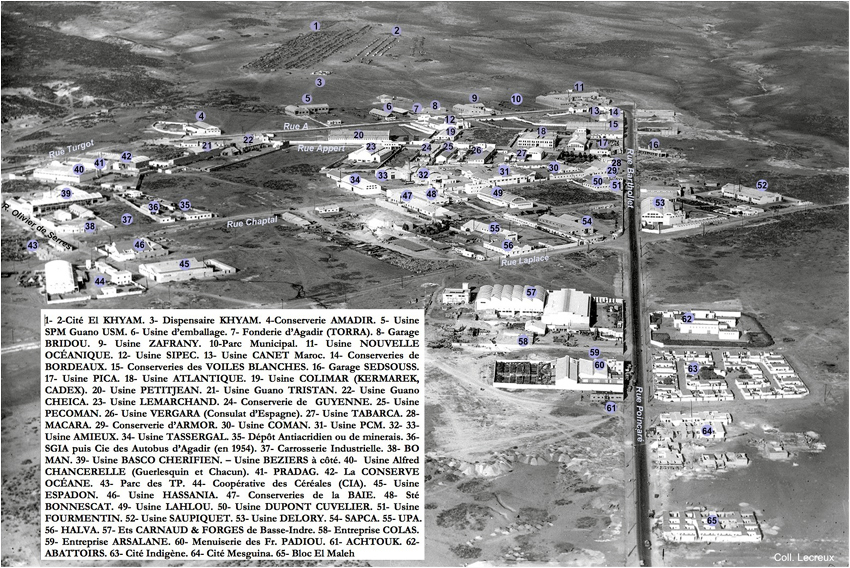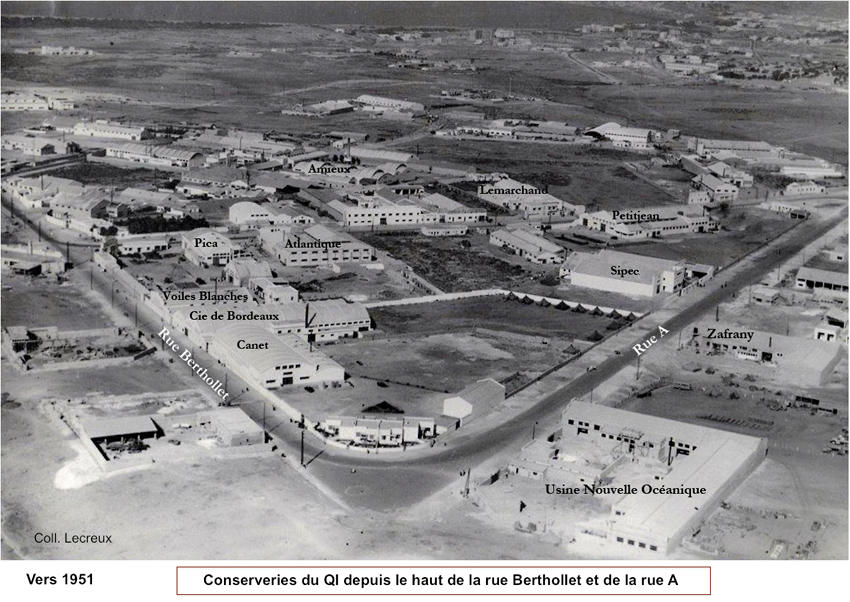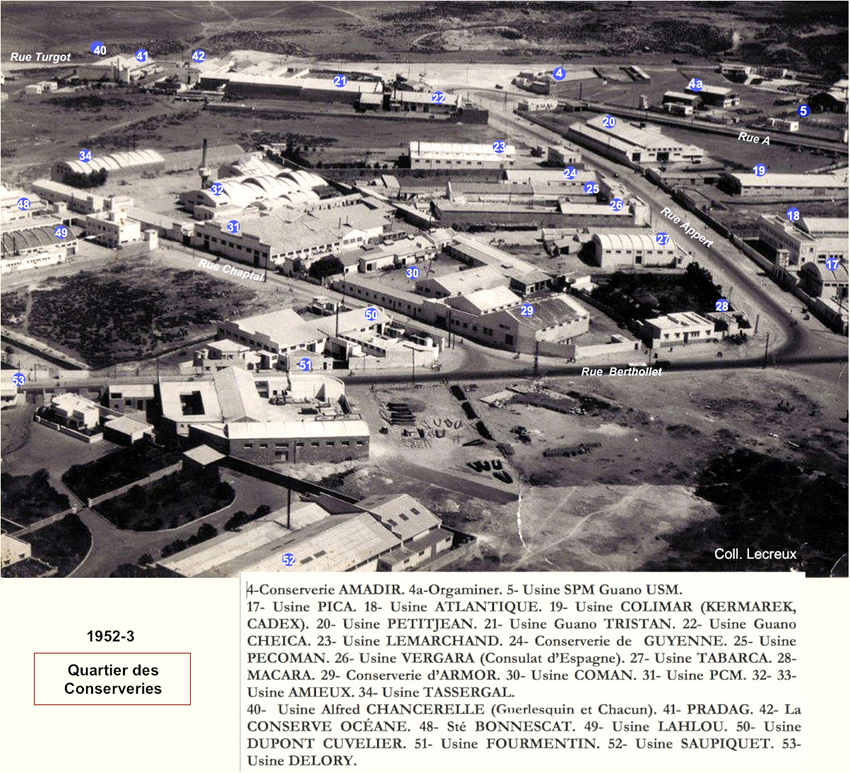Un des problèmes récurrents rencontrés par les conserveurs fut celui de
l'irrégularité des apports en poissons. La sardine
n'était pas toujours au rendez-vous aux portes d'Agadir
et encore moins toute l'année. Il fallait aller la chercher
là où elle se trouvait ou se déplaçait,
c'est-à-dire vers Ifni, pérégrinant volontiers
au large où les bâtiments espagnols semblaient faire
des pêches miraculeuses.
La sardine adulte a cette spécificité de prospérer
dans des eaux fraîches de 15/16°, sauf en période
de ponte où il lui faut des eaux chaudes de 18 à
24°. Or, les eaux marocaines ne comptaient que trois poches
froides : une au nord du Maroc vers le cap Spartel, la plus importante
entre le cap Cantin et le cap Ghir (entre Safi et Agadir) et
une vers Ifni.
En conséquence, pour accéder aux lieux de pêche
qui variaient selon la période de frai des sardines et
du déplacement des eaux froides, une flotille adaptée
avec du personnel qualifié, capable de s'éloigner
des côtes et non de caboter s'avéra indispensable.
Pour faire face à l'absence de poisson
à certaines périodes de l'année, les conserveries
durent étendre leur activité à d'autres
secteurs et alterner les types de fabrication. Les conserveurs
firent des confitures d'abricots, de la viande en conserve, des
conserves de légumes de la vallée du Souss (petits
pois, haricots verts) et de la sauce tomate.
Les conserveurs apprirent à ne rien laisser perdre du
poisson, à récupérer les invendus, à
valoriser les résidus en les transformant en engrais (matières
azotées), farines et huiles de poissons.
On se souvient des odeurs prégnantes de ce qu'on appelait
le "guano" autour de ces usines (le véritable
guano étant le résultat des déjections d'oiseaux
marins).
Certains conserveurs s'équipèrent
en matériels spécialisés et établirent
en annexe de leurs locaux un atelier supplémentaire de
traitement de leurs propres déchets.
D'autres mirent au point la recette d'une fameuse essence d'orient
qui permettaient de créer des perles irisées, à
partir des écailles de poissons.
Enfin et non des moindres, un autre problème auquel furent confrontés les conserveurs concernait
la main d'œuvre féminine dont l'habileté dans
ce domaine était essentielle et irremplaçable (dans
une conserverie 90 % de la main d'œuvre est féminine).
Elle était en nombre insuffisant à Agadir.
En 1947, M. Setout, directeur de l'usine Amieux (siège
social à Nantes) et chef de file des conserveurs, se plaignit
que certaines usines tournaient à 80 % seulement, faute
de main d'œuvre. Des prospecteurs furent envoyés
dans les douars environnants avec l'assentiment du général
Miquel (commandant de région). Des camions "ramassaient"
les ouvrières et les ramenaient le soir dans leurs villages.
En 1948, les usines ne tournaient plus qu'à 40
% faute de pêcheurs pour les chalutiers et faute d'ouvrières
pour les conserveries. Malgré cet état de faits,
les conserveurs refusèrent de mettre la main à
la poche pour loger les ouvrières à proximité
des usines. Certains créèrent de minuscules médinas
qui ressemblaient souvent à "des cages à
lapins" pour disposer des ouvrières "sur
le champ" quand le poisson arrivait.
Ce fut la Municipalité d'Agadir et le Service de Santé
régional avec la "Toubiba", Dr Marianne Langlais
qui permirent de débloquer la situation en créant
deux douars de 320 et 140 tentes environ (Col. Mathieu, p.
305) avec un service médico-social et des assistantes
sociales, douars alimentés en eau potable par camions
citernes puis par canalisations rattachées au réseau
général.

Dans les années 50, le nombre des conserveries resta stationnaire. Autour
des conserveries se développèrent des entreprises
répondant à leurs attentes. Pour répondre
aux besoins des conserveurs en matière d'emballage, les
établissements de J.J. Carnaud & Forges de Basse
Indre créèrent à Agadir une importante
usine de fabrication de boîtes métalliques, équipée
de chaînes de fabrication ultra modernes. Les Éts
Carnaud n'oublièrent pas leur personnel et créèrent
pour celui-ci, la petite cité d'habitation Carnaud proche
de l'usine.
Des stations d'emballage et des caisseries se mirent en place
à côté des conserveries.