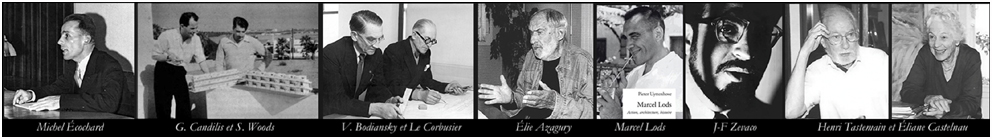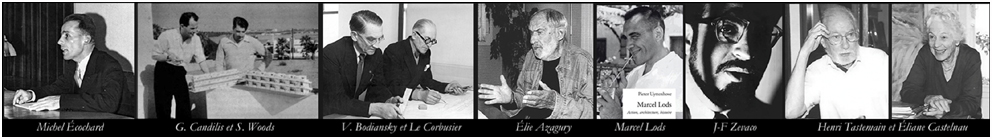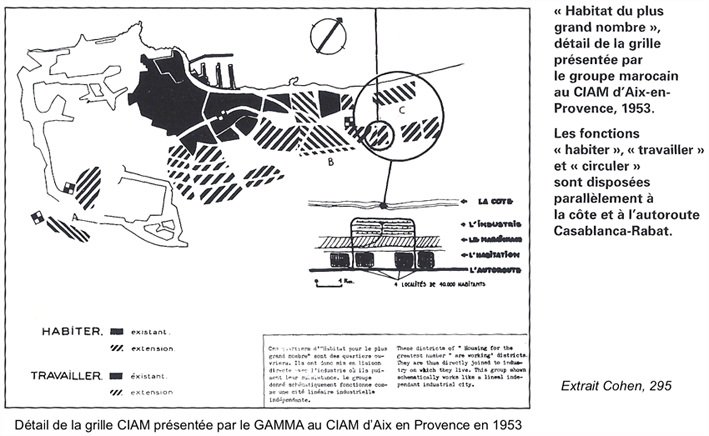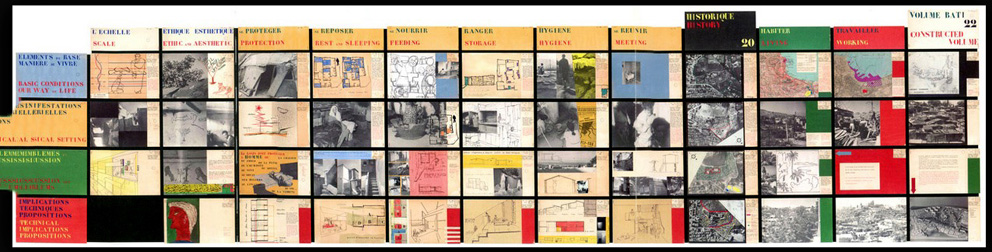Les architectes qui bâtirent la Ville Nouvelle d'Agadir
après le séisme, formaient déjà dans
les années 50, un groupe structuré par des origines
communes et des itinéraires voisins. Beaucoup avaient
été "recrutés" par Michel Écochard
(directeur du Service de l'Urbanisme au Maroc) dans les ateliers
parisiens où ils avaient reçu une formation très
classique tout en adhérant spirituellement aux préceptes
modernes. La plupart étaient nés au Maroc ou y
avaient grandi, porteurs d'une double culture comme Azagury,
Zevaco, De Mazières, Verdugo, Amzallag (Nadau, 160).
"Nous étions tout à fait au courant
de l'évolution du travail entrepris au Maroc. On suivait
tout cela de près car c'était considéré
comme avant-gardiste" (extrait d'un entretien avec l'architecte
Georges Candilis, réalisé par Marlène
Ghorayeb, Paris, juin 1993).
À la fin des années 40, de nouveaux groupes
émergent dans les congrès internationaux d'architecture
moderne (CIAM).
Pour le groupe marocain, l'initiative en revint, semble-t-il
à Sigfried Giedion, historien et secrétaire
général des CIAM, qui souhaitait obtenir la contribution
de Michel Écochard qu'il avait rencontré
à New-York.
L'action d'Écochard, directeur du Service
de l'Urbanisme au Maroc, trouvera un écho mondial grâce
aux congrès internationaux d'architectures.
Écochard est admis en 1949 au Congrès de Bergame
en tant que "membre individuel" des CIAM pendant que
le groupe marocain d'architectes se structure.
L'action d'Écochard sera déterminante : à
la tête du service de l'Urbanisme, Écochard applique
un discours fonctionnaliste et constitue le relais de
la diffusion de la Charte d'Athènes (Cohen et Eleb,
1998, p. 306).
|
 |
À Casablanca, dans les années 50, les jeunes
architectes profitent d'un climat cosmopolite et travaillent
aux côtés d'architectes de toutes origines ; dans
un pays où la demande immobilière est très
forte, leur attention se porte avec enthousiasme sur les mouvements
architecturaux du monde entier (Lucie Hofbauer, Transferts
de modèles architecturaux au Maroc, Les cahiers de
l'EMAM, 2010).
L'espace de dialogue pour ces architectes sera le GAMMA
(Groupement des architectes modernes marocains). Les réunions
ont lieu à Rabat, là où habite Michel Écochard.
En novembre 1949, les conférences de
l'architecte Marcel Lods (architecte qui réalisa
avec l'ingénieur Vladimir Bodiansky (ATBAT-Afrique),
l'actuel Hôtel de la Province d'Agadir en 53-54) et de
Bodiansky, tous deux membres des CIAM, célèbrent
avec enthousiasme les vertus du zonage fonctionnel et montrent
les parrainages d'Écochard dans le cadre de ces
congrès (Cohen, 291).
|
 |
À l'issue du congrès d'Hoddesdon
(R-U, 1951), le GAMMA est accepté comme branche
à part entière des CIAM.
Le projet du nouveau quartier Yacoub el Mansour étudié
par les Services d'Écochard pour Rabat et publié
sous la signature du "Groupe CIAM du Maroc",
constitue selon Cohen le véritable bulletin de naissance
public du GAMMA (Cohen, 307).
La formation du GAMMA constitue l'aboutissement des actions convergentes
et successives d'Écochard et de Georges Candilis
tous deux préoccupés par le logement social collectif
(Cohen, 306).
|
Ces jeunes architectes travaillant au Maroc, présentent
aux CIAM au début des années 50 de nombreuses réalisations,
alors qu'en France, les architectes ne parviennent pas à
bâtir leurs projets.
Les réalisations de ces architectes font l'objet de publications
dans la revue "Architectures d'aujourd'hui ".
Les architectes Marcel Lods et Georges Candilis font partie du
comité de rédaction de la revue L'Architecture
d'aujourd'hui (N°60, VII, juin 1955).
|
Les jeunes architectes marocains qui exercent au Maroc : Élie
Azagury, J.-F. Zevaco, Henri Tastemain ou Jean Chemineau
présentent aux CIAM au début des années
50 un certain nombre de réalisations individuelles : commandes
privées (villas, immeubles, cinémas, stations-services
etc.) et commandes d'État (Hôpitaux, collèges
et lycées, etc.).
Se réclamant du GAMMA, cette génération
d'architectes sera reconnue internationalement sur la scène
des CIAM (Cohen et Eleb, 1998, 307).
| Écochard et le
Service de l'Urbanisme |
Loin de se contenter d'être un relais
dans la diffusion de la Charte d'Athènes, l'équipe
du Service de l'Urbanisme au Maroc mène une réflexion
qui déplace vers le Sud le discours fonctionnaliste.
Il s'agit de rompre avec les problématiques centrées
sur les taudis urbains et îlots insalubres européens
en prenant en compte les usages et habitus des ruraux
marocains transplantés en bordure des villes (Cohen, 306).
La réflexion théorique et les projets du Service
de l'Urbanisme s'appuient à la fois sur l'observation
des modes d'habiter des ruraux dans les villages et dans les
bidonvilles et sur la critique des réalisations antérieures.
|
Ils s'appuient sur les études réalisées
par des sociologues comme R. Montagne, J. Berque et Dj. Jacques-Meunié
et sur les habitudes séculaires pour mettre en place une
architecture fonctionnelle, sobre et vernaculaire.
Écochard cherchera à faire vivre dignement une
catégorie de population pauvre qui a ses traditions en
développant une théorie sur l'habitat du plus grand
nombre en s'appuyant sur la Charte d'Athènes pour créer
des cités sur une trame horizontale de maisons sur cour
8 x8 groupées en unités vicinales équipées.
|
Dès 1952, les travaux de l'ATBAT-Afrique
(filiale basée à Casablanca, animée au Maroc
par l'architecte Georges Candilis et l'ingénieur Bodiansky)
seront pris en compte par les CIAM quand Vladimir Bodiansky
fera admettre par le Conseil Économique et Social de l'ONU
l'importance de l'Habitat du plus grand nombre.
Ce document sera discuté en 1952, à la réunion
préparatoire du CIAM 9 (Aix en Provence 1953)
à Sigtuna.
Si Candilis, Woods et l'ATBAT-Afrique furent des rassembleurs
(Élie Azagury, cité par Lucy Hofbauer, 2007), les
clivages existants entre les membres français des CIAM
finiront par se répercuter au Maroc.
Ainsi, au sein d'une même agence, l'ATBAT Afrique (basée
à Casablanca à partir de 1951), l'ingénieur
Bodiansky est affilié au groupe Lods, alors que Candilis
restera assez longtemps proche de Le Corbusier.
Quant aux jeunes de l'équipe Écochard, ils sont
affiliés au groupe dénommé "La Cité"
animé par Roger Aujame (Cohen, 307).
|
 |
En 1953, l'équipe de l'ATBAT-Afrique est rejointe
par l'architecte Shadrach Woods et réalise une
opération expérimentale aux Carrières
centrales de Casablanca. Écochard conscient que l'habitat
en rez-de-chaussée horizontal ne peut se décliner
à l'infini, suggère à Candilis d'explorer
une solution à la trame horizontale.
L'ATBAT-Afrique s'intéresse aux architectures du
sud marocain comme les greniers citadelles ou les villages fortifiés
de l'Atlas afin de "réaliser un habitat collectif
tenant compte du climat, de la culture, et du contexte local"
(Curtis, 2006, p. 443).
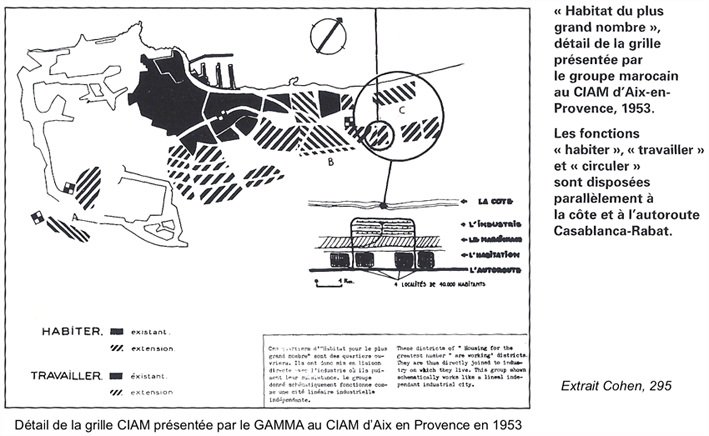
Vladimir Bodiansky, les architectes Georges Candilis,
H. Piot et Shadrach Woods poursuivent le travail de recherche
pour l'Habitat du plus grand nombre (thème pérenne
des CIAM) aux Carrières Centrales de Casablanca
et créent en 1953 une Cité expérimentale
pour une population musulmane à faibles revenus.
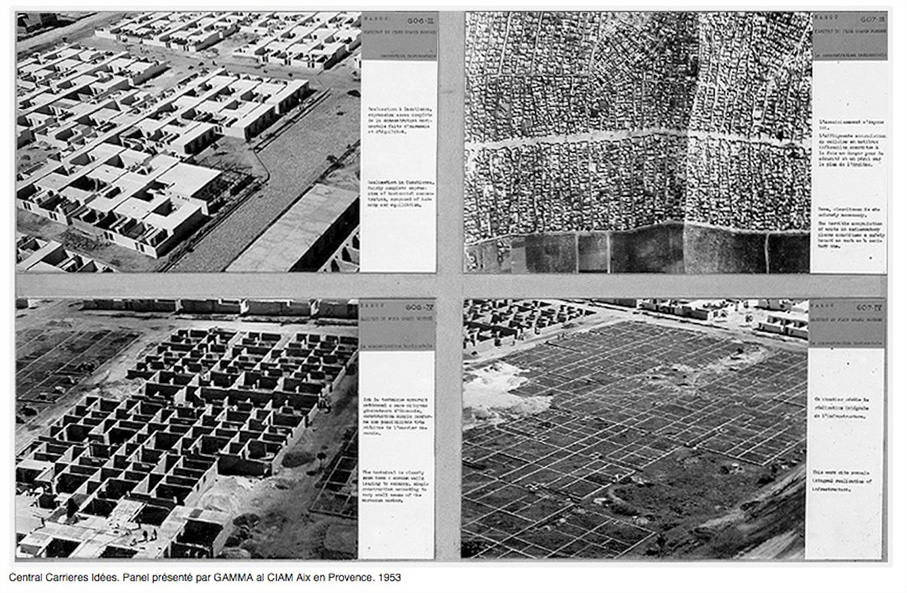
Pour ces architectes, il s'agit de trouver des formes architecturales,
des structures prenant en compte les conditions économiques
et sociales des plus démunis en leur apportant un élément
essentiel, la dignité (Les Carrières Centrales
à Casablanca, immeubles Semiramis et Nids d'abeille).
Au sein de l'immense nappe horizontale de maisons à patio
de type Écochard, trois petits immeubles collectifs
proposent une solution nouvelle : une petite tour de Bodiansky,
un immeuble Semiramis et un immeuble Nid d'abeille,
solution radicalement différente de ce qui s'était
fait jusqu'à présent. Il s'agit d'interrompre la
trame horizontale d'Écochard et d'explorer des modes de
composition différents de la trame 8 x 8 dans l'espace.
Au lieu d'aligner des blocs sur une trame horizontale, les
architectes cherchent à les articuler entre eux, et à
créer des espaces rompant la monotonie tout en luttant
contre le gigantisme et en humanisant l'habitat. Cette présentation
conteste l'éclosion de bâtiments à l'infini
et ouvre le champ de constructions déclinées en
vertical de la trame horizontale d'Écochard.
Candilis constate que "les kasbahs du Sahara,
les ksour(s) villages fortifiés de l'Atlas, les greniers
citadelles collectifs reflètent cette aptitude des gens
à vivre l'un à côté de l'autre en
respectant l'intimité familiale, tout en gérant
d'un commun accord les affaires d'intérêt commun"
(cité par Cohen et Eleb, légende d'un panneau de
l'exposition "La Cité verticale" au CIAM d'Aix-en-Provence
de 1953).
|
Ces bâtiments du Maroc enthousiasment les architectes
Alison et Peter Smithson pour qui ces bâtiments
représentent la plus grande réussite depuis l'Unité
d'habitation de le Corbusier à Marseille.
"Alors que l'Unité d'habitation était le
point d'aboutissement d'un mode de pensée : l'habitat
formulé il y a quarante ans, l'importance des bâtiments
marocains réside dans ce qu'ils sont la première
manifestation d'un nouveau mode de pensée.
|
Ils sont donc présentés comme des idées,
mais leur réalisation en vraie grandeur nous convainc
qu'ils représentent un nouveau principe universel"
(cité par Cohen et Eleb, " Collective Housing in
Morocco ", Architecture Design, janvier 1955, p. 2).
C'est la rencontre de la problématique universaliste
de l'architecture moderne et de la volonté d'adaptation
aux cultures et aux identités locales de cette génération
(Cohen et Eleb, 332).
Une quinzaine d'architectes du GAMMA participent en 1953 au
Congrès d'Aix en Provence.
Ils présentent les réalisations du Service de l'Urbanisme
avec des comparaisons photographiques à l'appui entre
les villes anciennes et les nouveaux quartiers.
La grille conçue par l'urbaniste Pierre
Mas en liaison avec Écochard pour le GAMMA
sur l'Habitat marocain rivalise avec celle de l'ATBAT-Afrique
sur l'Habitat du plus grand nombre préparée
par Candilis à laquelle Mas a également travaillé.
|
Le GAMMA comprend principalement les architectes
Élie Azagury, Domenico Basciano, Éliane
Castelnau, Béraud, Georges Candilis, Jean
Chemineau, Georges Delanoé, Édouard
Delaporte, Michel Écochard (en dépit
de son départ du Service de l'Urbanisme au Maroc),
R. Deneux, Wolfgang Ewerth, Robert Forichon, Georges
Godefroy, Gaston Jaubert, Pierre Mas, Élie
Mauret, Paul Perrotte, Shadrach Woods, Henri
Tastemain, Jean François Zevaco (Lucy Hofbauer,
nbp 4, Le mouvement moderne marocain à l'épreuve
du tourisme, Centre Jacques-Berque, 2018).
|
Les projets marocains rencontreront un vif succès aux
CIAM.
Dans la perspective du congrès de Dubrovnik (CIAM 10,
1956), le groupe prépare deux grilles présentant
les recherches en cours au Maroc prolongeant celles qui avaient
eu tant de succès à Aix en Provence.
Jean Chemineau et Henri Tastemain, accompagnés
d'Élie Azagury et de Louis Riou participent
aux travaux de la commission du Congrès sur "l'Urbanisme
comme partie de l'habitat" mais ne présenteront pas
leurs grilles.
Dans la période qui sépare le congrès
de Dubrovnik (CIAM 10, 1956) de celui d'Otterlo (Team X, 1959),
Jean Chemineau poursuivra depuis le Maroc qu'il quittera
en 1957, un travail épisodique de délégué.
Élie Azagury représentera le GAMMA
au Congrès d'Otterlo en 1959 (Cohen, 420).
|
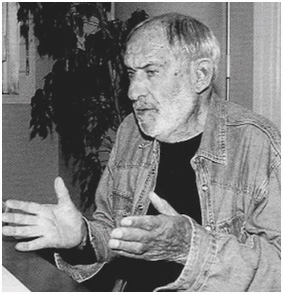 |
Le GAMMA constituera un espace de dialogue pour
les jeunes architectes marocains Jean François Zévaco,
Jean Chemineau, Élie Azagury ou Gaston
Jaubert.
Les discussions ont lieu à leur domicile et ont pour objectif
de faire exister la branche marocaine dans les CIAM.
En 1956, Jean-François Zévaco reçoit
une convocation intitulée GAMMA CIAM Maroc qui
précise que la prochaine réunion prévue
pour le 7 mars 1956 à Rabat est reportée au mardi
13 mars à 21 heures, chez Chemineau, rue Normand
à Rabat (Hofbauer, 2007, Annexe 18).
La liste des destinataires concerne les architectes Aujard,
Élie Azagury, Domenico Basciano, Jean Chemineau,
Delanoé, Édouard Delaporte, Deneux,
Ewerth, Forichon, Godefroy, Gaston Jaubert,
Pierre Mas, Mauret, Perrotte, Louis Riou,
et les Tastemain Henri et Éliane Castelnau.
La présence de Forichon et de Godefroy qui
travaillent au Service de l'Urbanisme au Maroc montre
combien le mouvement est lié à l'équipe
d'Écochard (Lucy Hofbauer, 2010).
La reconstruction d'Agadir après le séisme, à
partir du Plan directeur de la ville et des plans d'aménagement
du bureau de l'Urbanisme, constituera la grande œuvre
commune dans laquelle se retrouveront les membres du GAMMA.
|
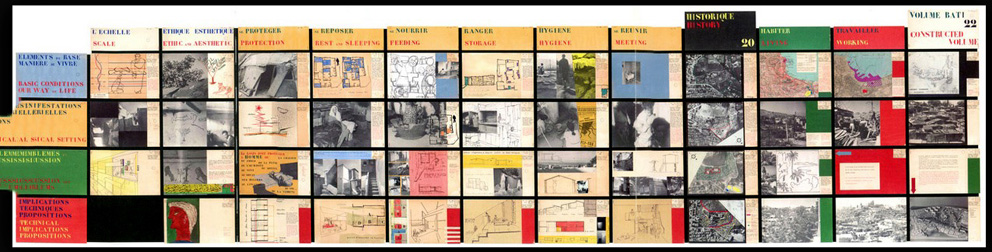
|