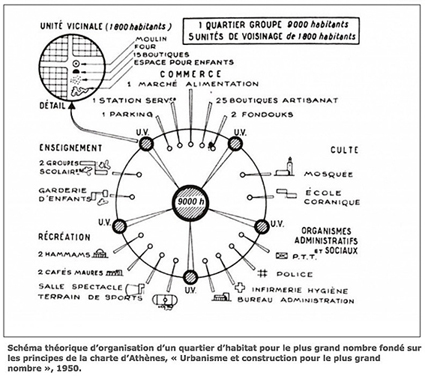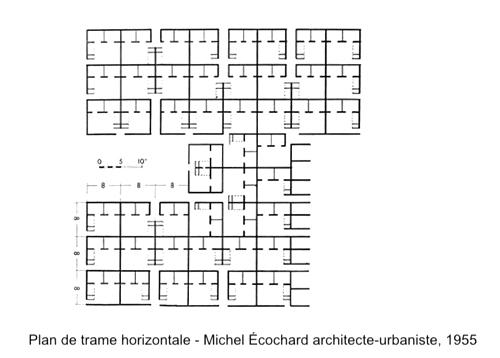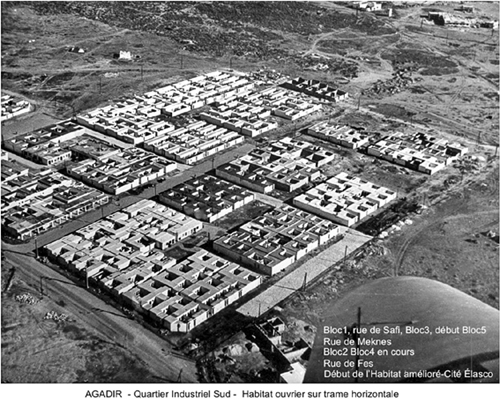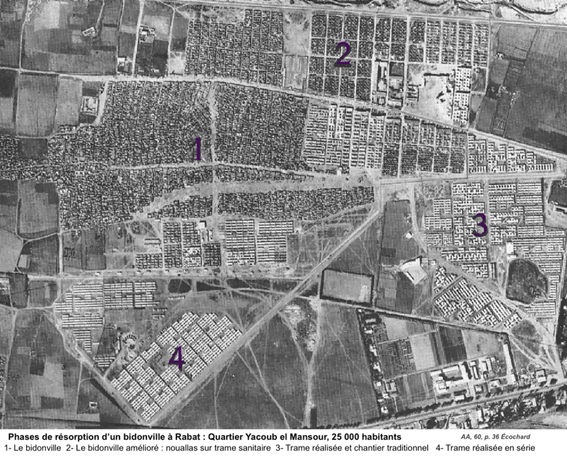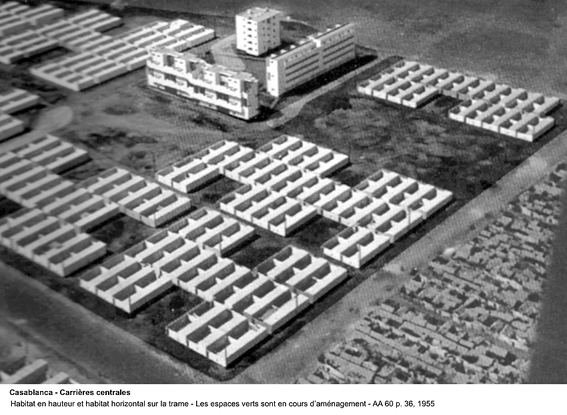" Rarement, une petite bourgade portée
en 50 ans au rang de grande ville internationale, présenta
aux hommes aussi totalement à nu, ses vicissitudes, ses
richesses, ses misères et sa grandeur pour qu'elles leur
servent d'enseignement " (Écochard, Casablanca -
le roman d'une ville, 1955, p.133).
Cette phrase de Michel Écochard aurait pu s'appliquer
à Agadir ; elle concernait Casablanca.
" L'urbanisme d'une ville, nous dit Écochard,
ne s'achève pas avec son plan, ses lois, la mise en place
de ses cités stellites, son programme de réalisations
dans le temps et ses achats de terrain. L'équipe des réalisateurs
doit rester sur place, vivre la vie de la ville et repenser sans
arrêt ses problèmes " (ib., 141).
|
Une conception nouvelle de l'urbanisme
Quand Michel Écochard fut appelé au Maroc
par le résident Eirik Labonne pour reprendre
en main le Service de l'Urbanisme, l'exode rural et le surpeuplement
urbain exigeaient des solutions urgentes.
Comparant le Maroc à la France, Écochard dira que
"cet accroissement de la population urbaine avait fait parcourir
au Maroc en 30 ans un chemin que la France avait lentement monté
en un siècle et demi".
La théorie de l'habitat pour le plus grand nombre
fut formulée à l'occasion d'une conférence
tenue en févier 1950 intitulée "Urbanisme
et construction pour le plus grand nombre".
|
"L'habitat marocain, disait Écochard,
a été depuis mon arrivée au Maroc en 1946
la préoccupation majeure du Service de l'Urbanisme. L'accroissement
démographique et l'afflux des populations rurales vers
les villes y entrainaient le surpeuplement de certains quartiers
et la création, à la périphérie,
de zones dites " bidonvilles " (300 000 personnes en
1947). Dans les deux cas, les conditions de vie y étaient
telles que le problème présentait un caractère
d'extrême urgence. Actuellement, dans la population urbaine
du Maroc, les Musulmans entrent pour 85%. C'est le problème
capital, celui du plus grand nombre" (Écochard
M., Habitat musulman au Maroc, l'Architecture d'aujourd'hui
n° 60, juin 1955, pp. 36-37).
|
Écochard mit en place une politique pluridisciplinaire
en s'appuyant sur les travaux de sociologues et d'ethnologues
sur les modes de vie des populations musulmanes, sur l'observation
des modes vernaculaires d'habiter des ruraux dans
les villages et dans les bidonvilles où ils s'étaient
transplantés et sur l'étude critique des réalisations
antérieures.
L'action d'Écochard trouva un écho mondial au travers
des Congrès internationaux d'architecture moderne (CIAM)
(Cohen, 306) ; la contribution marocaine provoquera un véritable
choc au Congrès d'Aix en Provence (CIAM 9, 1953).
Pour Écochard, il s'agissait de concevoir
l'habitat selon les habitudes traditionnelles et les catégories
sociales.
Il reprit en 1946 les catégories admises par l'administration
en les appliquant non aux personnes mais aux quartiers selon
des critères hétérogènes religieux
pour les musulmans et les juifs marocains, nationaux pour les
européens ; la création d'immeubles pour européens
et de villas pour marocains aisés ne posait pas de problèmes
: ce qui posait problème, c'était de trouver pour
les personnes à très faible revenus, une ou des
solutions satisfaisantes sur le plan de l'hygiène, reproductibles
au plus faible coût, tout en évitant la spéculation
sur le prix des terrains.
|
Dans le cas de "l'Habitat pour le plus
grand nombre" qui devait être réalisé
en grande partie avec l'aide de l'État et au moindre coût,
mais sans rien sacrifier à l'hygiène et au confort
minimum pour une population trop pauvre pour payer des loyers
demandés, il fut nécessaire d'établir une
théorie de l'habitat du plus grand nombre allant
de l'aménagement du quartier au plan de la cellule
individuelle pour trouver une solution financièrement
réalisable portant sur la surface de voierie, son entretien,
la longueur des égouts et des canalisations et sur la
construction (Écochard, 102-103). Au centre de ce cadre
urbain, il importait de préciser le type d'habitation
susceptible de constituer le tissu cellulaire de ces cités
nouvelles.
|
Il importait également de prévoir un habitat
évolutif selon l'évolution du standard de vie
ou de construire simultanément différents types
d'habitation correspondant à des niveaux de vie différents.
Un plan de quartier pouvait recevoir soit des habitations collectives,
librement disposées et satisfaisant aux conditions d'orientation
et d'isolement nécessaires, soit des habitations individuelles
de différentes dimensions, soit même un habitat
précaire mais disposé sur une infrastructure de
quartier définitif (trame sanitaire) comprenant
aux emplacements prévus une partie des voies, des égouts
et un minimum de bâtiments sociaux (écoles, dispensaire)
(Écochard, 104-105).
Zoning et Unité de voisinage
À l'échelle du quartier, Écochard préconisa
"l'unité de voisinage" avec des
équipements spécifiques (hammam, mosquée,
école coranique etc…) pour 1 800 habitants,
soit une densité de 350 habitants par ha.
Ces unités groupées à 4 ou 6 constituaient
une cité satellite ou quartier, pourvue
de tous les aménagements permettant une vie autonome.
Les centres ainsi créés ne dépassaient pas
30 à 40 000 habitants.
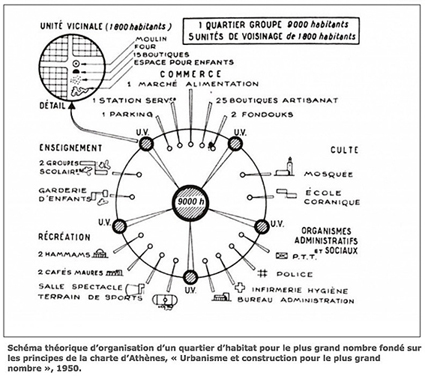 |
Chaque quartier (groupant 5 unités
de voisinage) était conçu pour une population
de 6 à 9 000 habitants, équipé de
services publics : école, dispensaire, centre commercial,
terrains de sport, hammam, mosquée.
L'objectif recherché était l'épanouissement
de la vie communautaire dans les "unités de voisinage"
(Écochard, 101). Chaque unité de voisinage était
centrée sur un groupe scolaire (écoles primaires,
école maternelle), un espace de verdure avec plantations,
un terrain de sport et un petit centre de commerce. Les dimensions
du quartier devaient être telles qu'un enfant n'ait pas
plus de 500 mètres à parcourir pour se rendre à
l'école, ni à traverser de voies de grande circulation
pour y accéder (Écochard, 101).
À l'intérieur du quartier d'une ville nouvelle,
la primauté allait à la circulation des piétons.
Il était essentiel de réduire les espaces de
voirie inutile, hantise d'Écochard en raison du coût
de leur construction et de leur entretien. Le quartier ne devait
pas être sectionné par les rues accessibles aux
voitures. Ainsi la circulation mécanique rapide devait
être rejetée sur le pourtour du quartier, sur de
larges chaussées correspondant aux grandes mailles du
réseau général de la ville. Dans le quartier
même, les voitures ne devaient avoir accès qu'à
un certain nombre de voies de pénétration aboutissant
à de petites places terminales organisées pour
leur stationnement. Il devenait possible de réduire des
kilomètres de voierie coûteuse si les habitations
ne s'ouvraient plus obligatoirement sur une rue ou un boulevard
mais sur de courts passages conduisant aux quelques grandes voies
de communication (Écochard, 99).
|
Trames horizontales, Trames sanitaires, petits immeubles collectifs.
Problème de l'espace construit
Écochard conçut une trame d'habitation horizontale
en rez-de chaussée de 8m x 8m censée permettre
toutes les combinaisons possibles sur une cour de 25 m2. Ces
64 m2 devaient permettre d'édifier un logement de deux
pièces normales avec un petit WC. La trame devait permettre
de loger 350 habitants à l'hectare.
Les quartiers étaient organisés sur une trame
dont l'élément de base était la parcelle.
En 1950, pour lutter contre les bidonvilles, Écochard
préconisa la création de simples "trames
sanitaires" infrastructures (voierie, égouts)
sur lesquelles on laissait s'installer une "sorte de bidonville"
amélioré dans un premier temps avant d'installer
des logements en dur au fur et à mesure des possibilités
financières de l'habitant (Anza, trames sanitaires
dans les années 50).
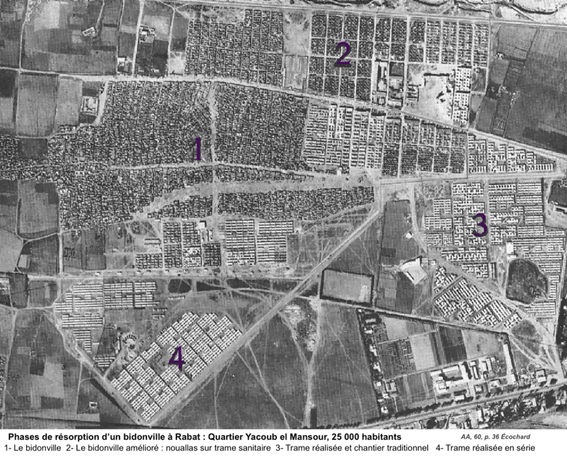 |
Dans sa forme spontanée, le bidonville
représentait sur un sol nu, une concentration anarchique
de cellules mobiles pouvant recevoir des densités extrêmes
de 1000 à 1100 habitants à l'hectare où
régnait le péril fécal par défaut
d'assainissement : ce que reprochait Écochard au bidonville,
c'était l'absence d'hygiène, l'absence de soleil
qui rendaient l'habitat insalubre.
C'est en ce sens que l'établissement d'une trame sanitaire
représentait une solution. La trame sanitaire consistait
à doter un secteur d'un équipement (chaussées,
adduction d'eau, égouts, etc.) se raccordant à
l'équipement municipal de base pour assurer aux habitants
des conditions de vie répondant aux exigences d'hygiène
en attendant la construction de logements en dur, en espérant
également que les habitants les construiraient eux-mêmes
en fonction de leurs moyens.
L'urgence était alors d'acquérir des terrains et
de les équiper avant que la spéculation n'intervienne
sur le prix des terrains.
Le directeur des Travaux Publics du Protectorat, M. Girard, demanda
l'autorisation de faire acheter des terrains par le Service de
l'Habitat, le plus grand nombre possible de terrains destinés
à l'habitat musulman pour prendre de court la spéculation.
|
Le quartier des Carrières centrales
à Casablanca fut la première expérience
d'application réelle de la trame 8 x 8 à
grande échelle élaborée par Écochard.
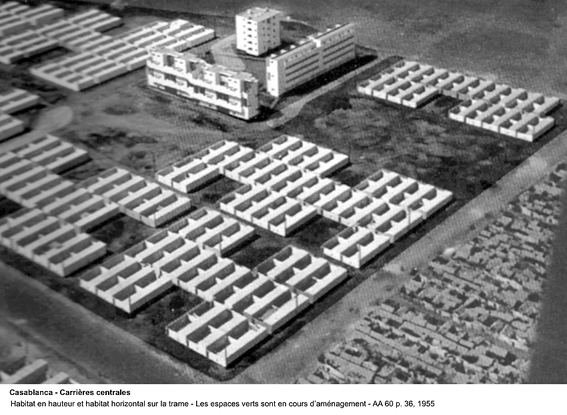 |
Il en résulta une nappe horizontale immense
de maisons à patio en rez-de-chaussée respectant
les habitudes traditionnelles de la population musulmane.
À la demande de Michel Écochard, il fut proposé
aux architectes Candilis et Woods et à l'ingénieur
Vladimir Bodiansky (du Bureau d'Études de l'ATBAT-Afrique)
de concevoir des solutions alternatives à la trame horizontale,
qui menaçait de s'étendre à l'infini, monotone
pour certains mais surtout gourmande en terrains.
Ils proposèrent une cité expérimentale de
150 logements, au milieu de l'étendue des maisons à
patio, en développant trois types d'immeubles selon
deux facteurs : l'ensoleillement et les habitudes traditionnelles
des habitants.
Ainsi furent conçus les célèbres immeubles
d'habitation "Sémiramis" et "Nid
d'abeilles" aux superpositions simples et idéalement
éclairés.
|
L'alternative verticale à la trame horizontale
ainsi réalisée consistait en petits bâtiments
collectifs disposés en U au milieu de la trame horizontale
:
- Une petite tour classique dessinée par Bodiansky
(ATBAT) ;
- L'immeuble Sémiramis, orienté à
l'Est et à l'Ouest, qui intégrait de façon
intéressante la morphologie du terrain en pente. Les logements
étaient distribués, un étage sur deux par
des coursives en façade menant aux patios privés.
Les appartements traversants présentaient environ 35 m2
habitables, aménagés simplement. L'escalier extérieur
conduisait aux coursives puis aux patios, au vestibule-cuisine
qui distribuait la pièce d'eau et les deux chambres. Trois
dispositifs filtraient le passage public-privé : escalier-palier,
galerie, patio.
|
- L'immeuble Nid d'abeille, orienté
Nord-Sud qui présentait des coursives sur le côté
Nord.
L'orientation solaire optimale de ces petits immeubles,
isolés sur terrain dégagé, était
fondamentale pour créer une ventilation favorable ; le
contrôle climatique des bâtiments fut réalisé
grâce aux espaces de transition intérieur-extérieur
(coursives et escaliers, balcons, loggias, patios couverts).
Cette combinaison verticale de la maison à patio permettait
de rompre la monotonie de la trame horizontale et d'économiser
du terrain.
Elle mettait en avant des éléments architecturaux
intermédiaires (galeries, terrasses) qui avaient tendance
à disparaître dans la conception des grands ensembles
en France sous prétexte d'une meilleure rationalisation
de l'espace.
|
"Inventer des logements simples, véritablement
économiques qui possèdent la qualité du
respect, ce n'était pas de la grande architecture mais
cela représentait autant de difficultés et demandait
plus d'imagination et de sensibilité que de construire
des palais" (Candilis, Bâtir la vie, un architecte
témoin de son temps, Paris, 1977, 185)
|
En 1953, Michel Écochard (130) Directeur du Service
de l'Urbanisme au Maroc, fut remercié par le Résident
Guillaume qui, comme le précédent résident
Juin, n'était pas favorable à ces idées.
|