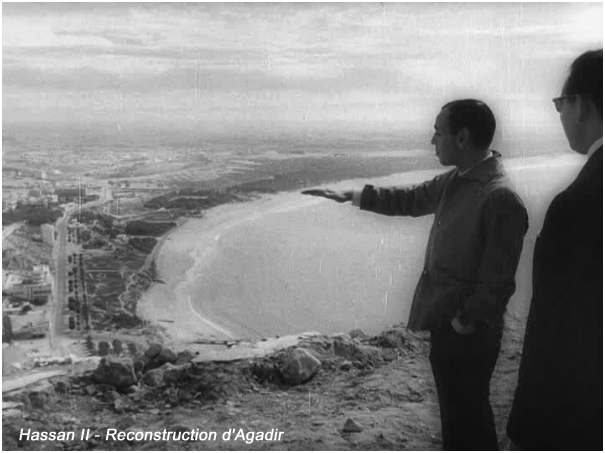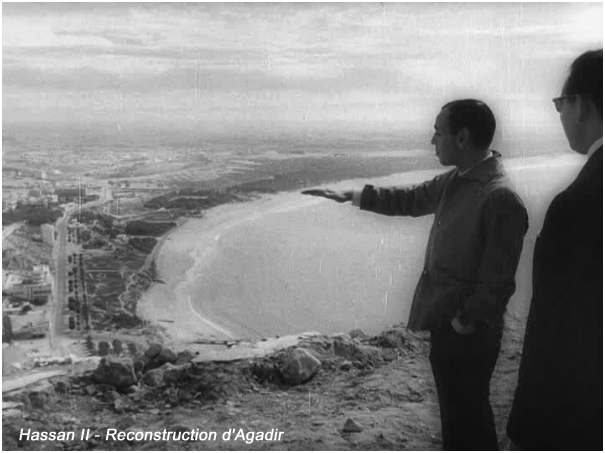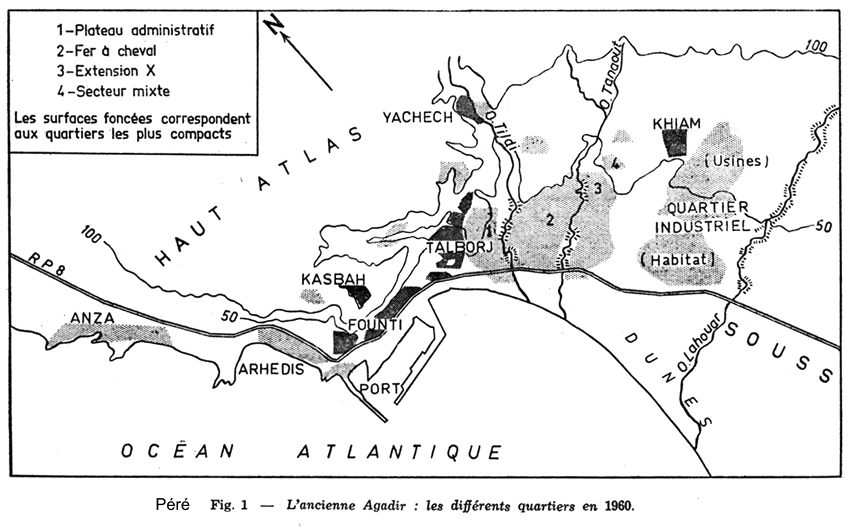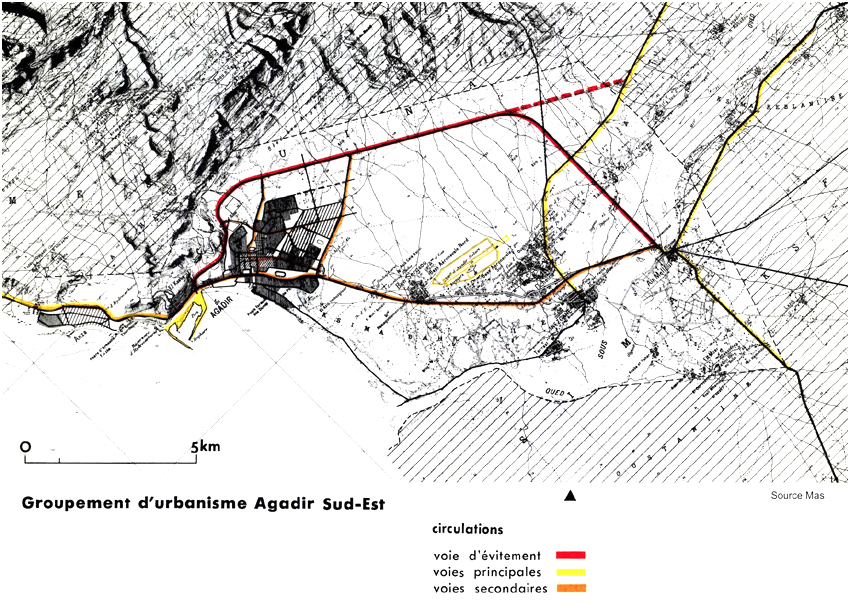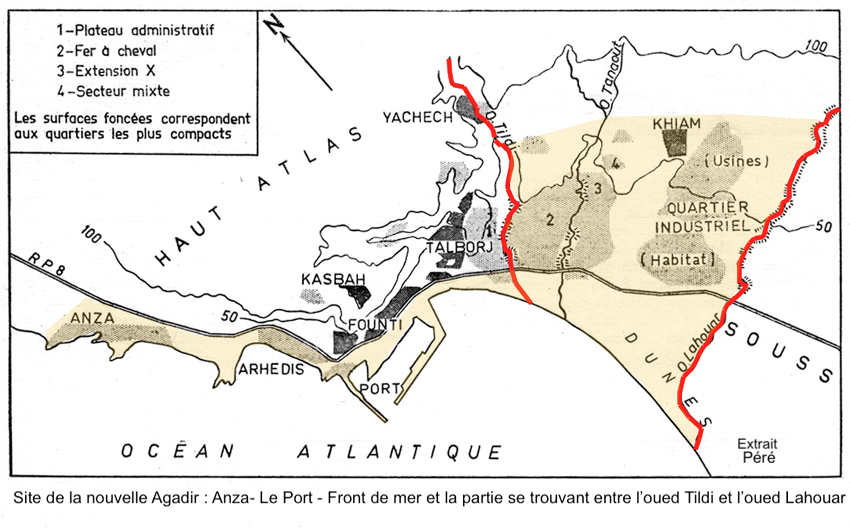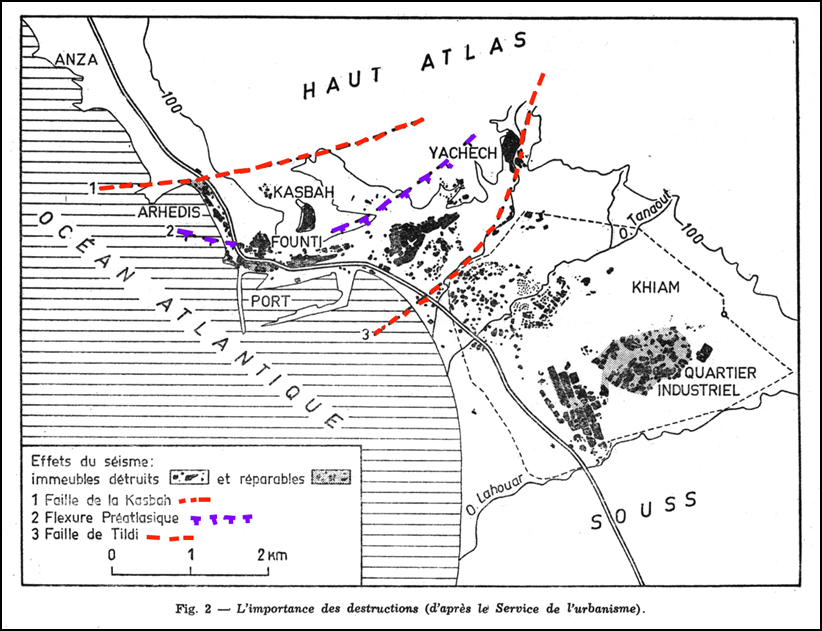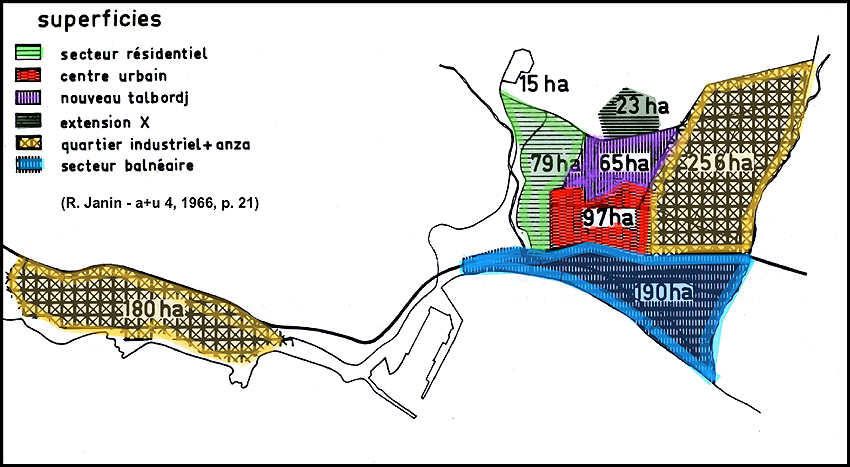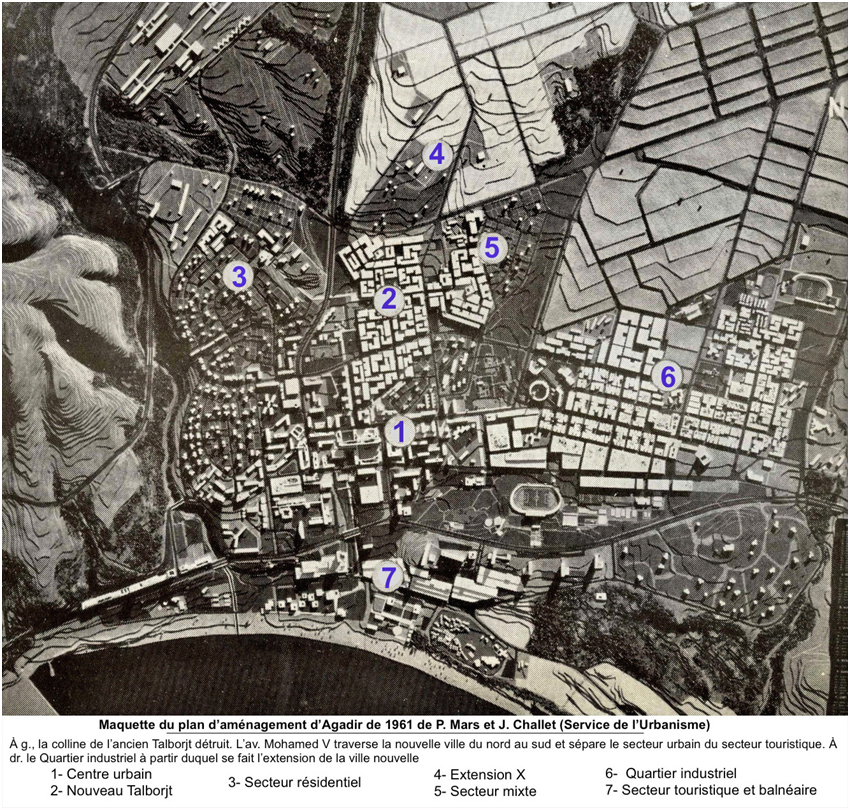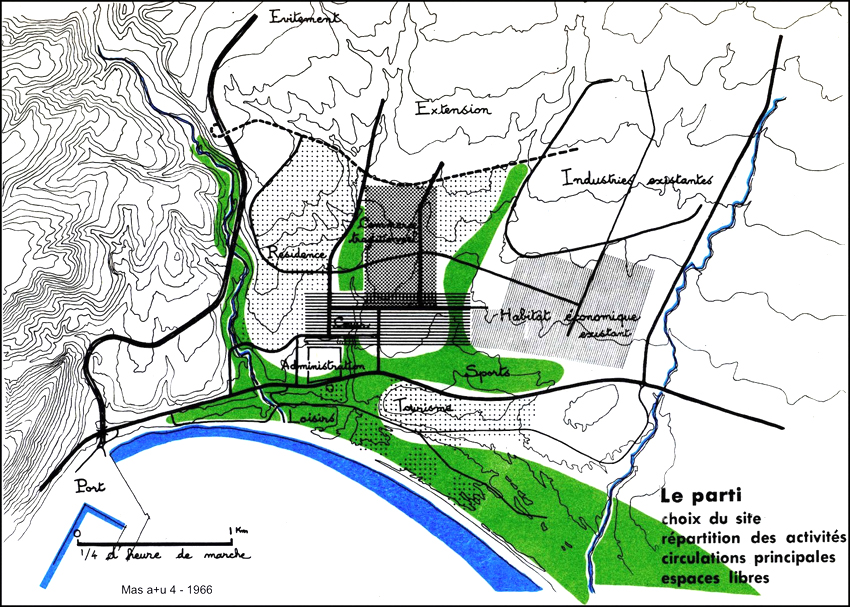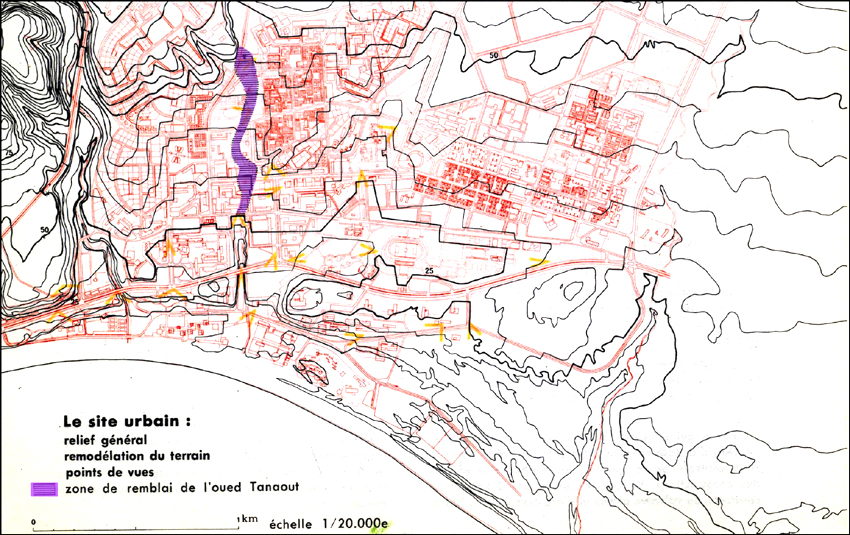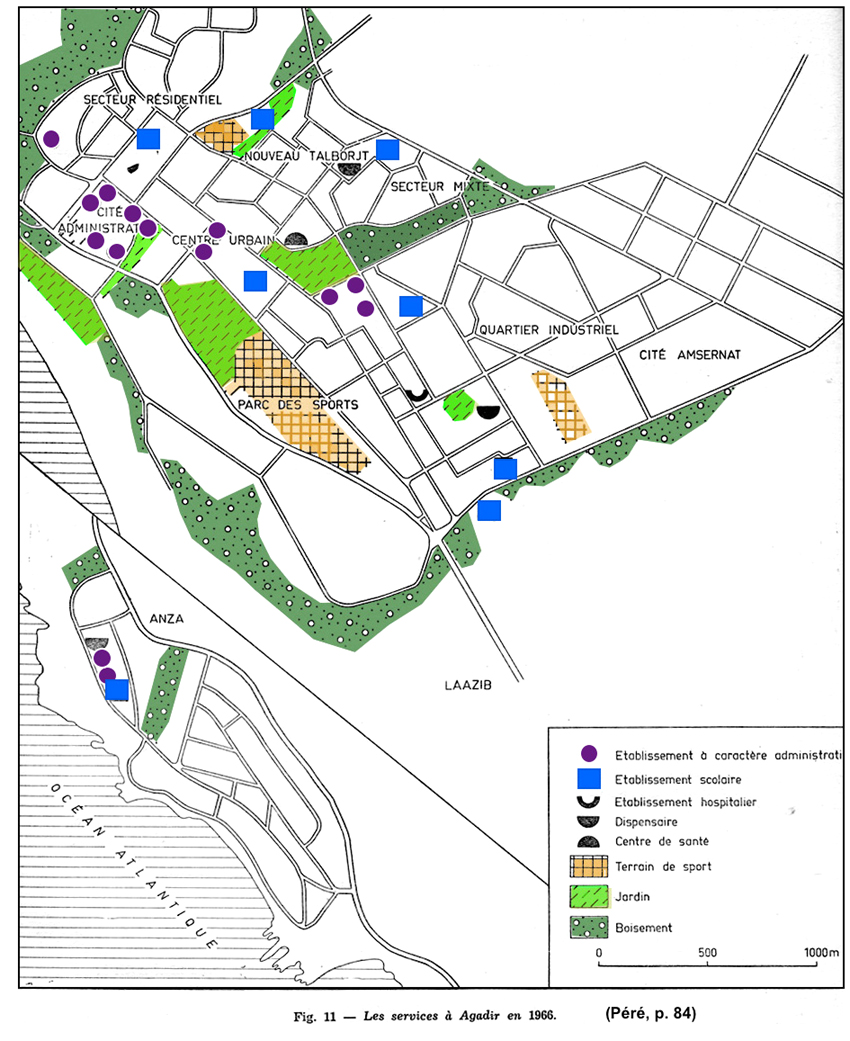Les études d'urbanisme furent réalisées
par le Service de l'Urbanisme, dirigé par l'architecte
Abdeslam Faraoui
puis par l'architecte Mourad
Ben Embarek
et spécialement par l'Équipe
du Bureau Central des Études dont faisaient partie
Pierre Mas (urbaniste),
Claude Beurret (architecte), Jean
Challet (paysagiste), J.-L. Lamarque Caupenne
(administrateur) (Mas, 6) (Péré,
57).
Ces études furent le fruit d'un travail d'équipe
pour la "résolution d'un problème complexe
où tous les détails furent longuement pesés
et franchement discutés entre tous". Les relations
et les contacts directs entre l'équipe de conception du
Service d'Urbanisme, l'Administration et l'équipe chargée
de la réalisation du Haut Commissariat à la reconstruction
d'Agadir (HCRA) permirent de mener à bien ce travail (Mas,
16).
Le Plan Directeur proposé par le Service de l'Urbanisme
du Ministère des TP de Rabat fut élaboré
en 6 mois.
Un premier rapport fut rédigé avant l'été
1960 traçant les grandes lignes du Plan directeur.
On y trouvait une ébauche de plan et des suggestions qui
seront reprises plus tard.
| |
Le plan
fit l'objet d'une consultation d'architectes et d'urbanistes
nationaux et internationaux. La plupart des architectes du Maroc
appelés à travailler à Agadir furent associés
aux études d'urbanisme, furent consultés au fur
et à mesure.
L'architecte Le Corbusier consulté, n'a pu accepter les
conditions du travail qui lui furent proposées (Mas, 6).
Par la suite, le Service de l'Urbanisme suivra la réalisation
ultérieure des plans en liaison avec HCRA dans tous les
domaines.
Le Plan Directeur sera approuvé par le roi Hassan II
à la fin de l'année 1961. |
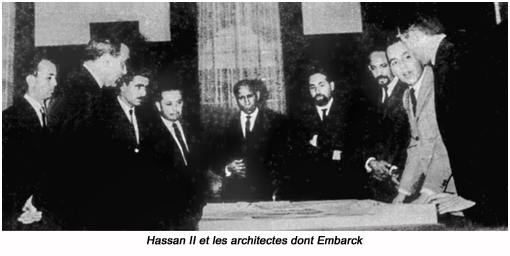 |
| Choix du site de
la nouvelle Agadir |
Au moment du séisme, Agadir, constituait le chef-lieu
d'une zone économique du royaume, bien individualisée.
9 quartiers constituaient Agadir : Anza, Le Port, Founti,
La Kasbah Offla, Yachech, Talborjt, Le plateau administratif,
La Ville Nouvelle, Le Quartier Industriel Sud. L'oued Lahouar
représentait la limite Sud de la ville.
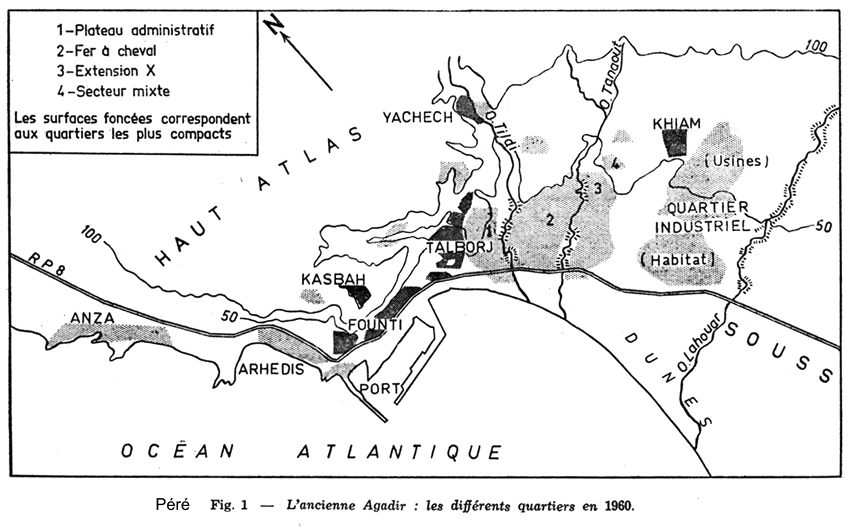
La ville et sa région disposaient d'infrastructures
importantes : un port construit en 1953 dont le trafic
progressait régulièrement et un aérodrome
prêt à recevoir des moyens courriers à réaction
(P. Mas, a+u 4, p. 6).
Agadir était aussi un point de passage routier obligé.
Suite au séisme, les études géologiques
permirent de déterminer les zones dangereuses qui furent
déclarées inconstructibles : c'est-à-dire
la zone pré-atlasique soit 250 ha correspondant
aux quartiers de Founti, la Kasbah, Talborjt,
Le Plateau administratif, Yachech.
La question était de savoir si la ville devait être
reconstruite sur son site actuel jusqu'à la frontière
de l'Oued Lahouar (ce qui permettait de conserver des
bâtiments réparables, des infrastructures peu touchées
par le séisme et évalués à plusieurs
milliards de DH, 500 ha équipés en voierie et réseaux
divers) ou si la nouvelle Agadir devait être déplacée
vers le S-E au-delà de l'Oued Lahouar en intégrant
les centres de la zone dite du Groupement d'urbanisme d'Agadir
Sud-Est.
| Groupement d'Urbanisme
d'Agadir et de sa banlieue Sud-Est (1942) |
Les problèmes de croissance et de spéculation
foncière qui s'étaient posées avec acuité
sous le Protectorat concernant Agadir avaient été
analysés par Michel Écochard
(Directeur du Service de l'Urbanisme sous le Protectorat
de 1947 à 1953) et avaient donné lieu en 1952 à
un Plan pour le "Groupement d'urbanisme Agadir Sud-Est"
dans le but de contrôler le développement rapide
de cette banlieue.
En effet, la ville érigée en municipalité
en 1930, avait souffert d'une spéculation foncière
provoquée par la libération des terres (autrefois
collectives) que les propriétaires avaient gelé
pour réaliser des plus-values faciles.
La croissance anarchique qui en avait résulté,
avait nécessité l'étude d'une réglementation
protégeant les zones agricoles et forestières environnantes
: c'est ainsi qu'avait été créé en
1952 ce "Groupement d'Urbanisme d'Agadir du Sud-Est"
(Péré, 52).
À partir du dahir du 30 juillet 1952 relatif à
l'urbanisme, un plan d'aménagement et de zoning
fut constitué, protégeant de constructions tous
les espaces nourriciers, zones irriguées notamment et
tous les secteurs naturels (dunes, forêts, etc.). Cela
avait permis de réserver des secteurs d'extension d'habitat
et d'industrie et d'éviter les risques de spéculation.
Le périmètre de la zone dite Groupement Sud-Est
comprenait :
- La Municipalité d'Agadir,
- Les Centres d'Inezgane, Dcheïra, Ben Sergao, Aït
Melloul,
- Des zones rurales dont un important secteur irrigué
et de vastes terrains collectifs,
- Un grand domaine forestier en bordure du littoral entre mer
et embouchure de l'oued Souss sur une ancienne zone dunaire maintenant
largement fixée.
L'aménagement de l'ensemble qui servit de cadre à
la ville était donc déjà planifié,
seule la future ville nécessitait une adaptation somme
toute légère pour devenir le Plan directeur
de la future ville d'Agadir de 1960 présenté
par le Service de l'Urbanisme (P. Mas, Plan directeur et plans
d'aménagement, Revue africaine d'architecture et d'urbanisme,
n°4, 1966).
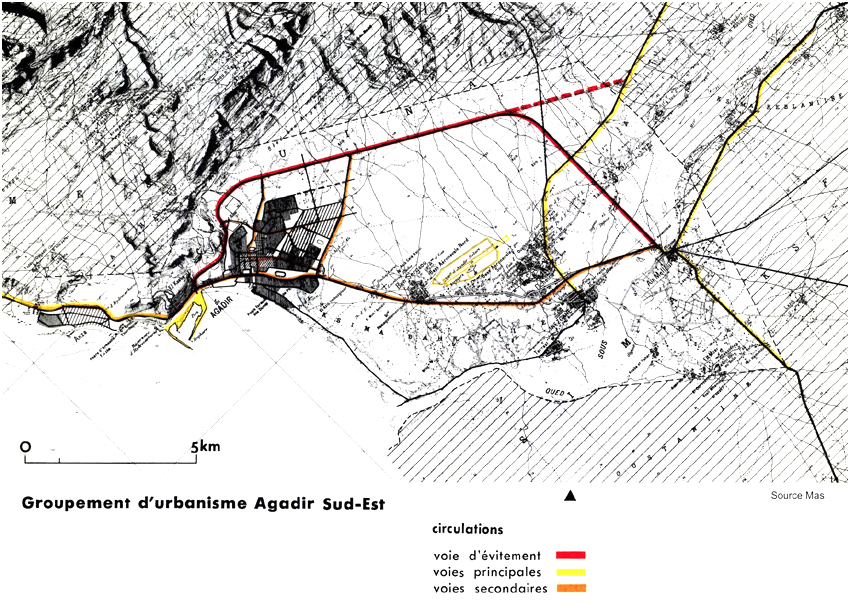

Le cadre juridique de ce groupement d'urbanisme demeura valable
après le séisme et n'eut à subir que de
légères retouches (P. Mas, Plan directeur et
plans d'aménagement, Revue africaine d'architecture et
d'urbanisme, n°4, 1966).
Finalement l'État opta pour le plan émanant
du Service de l'Urbanisme qui maintenait la ville dans son ancien
emplacement comprenant Anza, Le Port, le front de mer et
la partie d'Agadir ancien entre l'oued Tildi et l'oued Lahouar.
La surface totale constructible dans le cadre de l'ancien plan
représentait environ 1.100 ha.
Dans cette surface : 250 ha furent déclarés
inconstructibles (Kasbah, Founti, Talborjt, Yachech, Plateau
administratif).
Parmi les 800 ha qui demeuraient constructibles : 500
ha étaient encore libres.
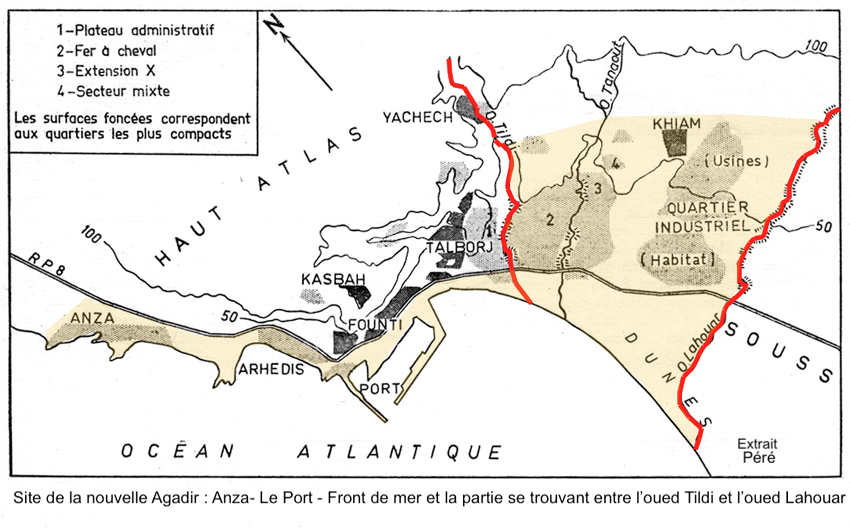
Le site retenu de la nouvelle Agadir dans l'ancien cadre avait
donc l'avantage d'intégrer dans la nouvelle cité
d'importantes installations qui n'avaient été que
faiblement endommagées comme :
- Le port, indispensable à l'activité
économique régionale ;
- Une partie importante de l'infrastructure urbaine
évaluée à 10.000.000 DH ;
- Des bâtiments rescapés réparables.
Une fois les zones constructibles et inconstructibles déterminées,
un inventaire général des immeubles endommagés,
des infrastructures, des réseaux divers fut réalisé
qui permit de dresser précisément la liste des
immeubles réparables pouvant s'intégrer
dans le nouveau plan : ainsi, le port, les routes et rues en
bon état, certains bâtiments (Hôtel de ville,
le Lycée, des cités du QI et d'Anza, le Tribunal,
d'Instance, l'Hôtel de Police, les écoles et groupe
scolaire du QI Sud) certaines villas du fer à cheval et
immeubles (Paternelle, Cassou, SATAS, etc.) furent conservées
et réparées.
Les bâtiments réparables des zones maintenues
(Ville Nouvelle, Secteur Mixte et Extension X, Anza et QI Sud)
étaient évalués à 40.000.000 DH.
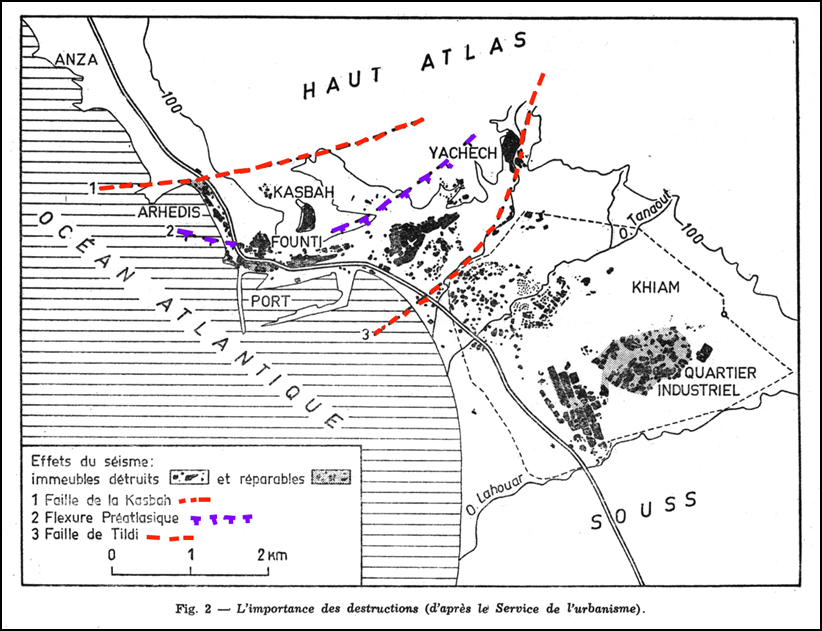
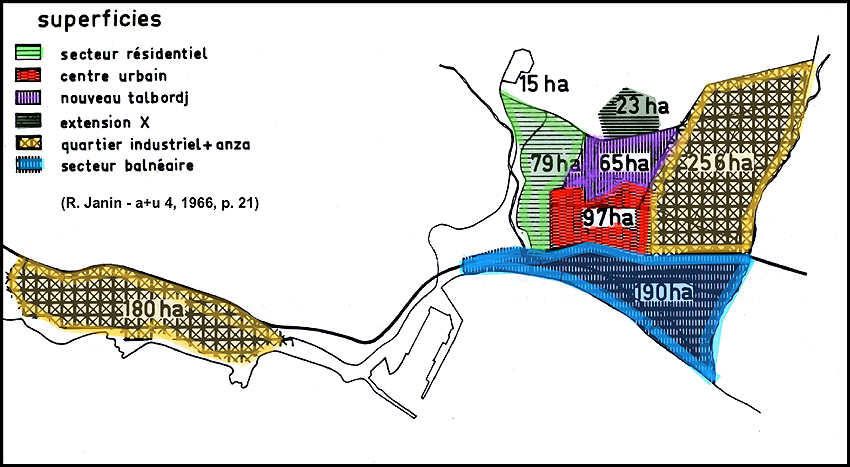
| Prévisions
concernant la population de la future Agadir |
À l'intérieur de cette zone de 800 hectares
au total, fut prévu dans une première phase,
l'équipement en voierie et des services publics
des 500 ha destinés à accueillir dans le
futur une population de 50.000 habitants.
Agadir comptait environ 35.000 habitants avant le séisme
; il fut estimé que le chiffre de 50.000 habitants
serait atteint avant 20 ans par une population en plein
essor. Toutefois, le plan directeur réserva des zones
d'extension vers le Nord-Est pour permettre à la population
d'atteindre 90.000 habitants.
Il était important, selon l'urbaniste Pierre Mas, de
recréer une "ville groupée", où
"l'association intime des activités les plus diverses
devrait assurer un développement de la vie sociale aussi
riche et intense que possible". Car selon Mas, la ville
d'avant le séisme, donnait l'impression "d'une
œuvre trop ambitieuse, impossible à achever".
"À côté de quartiers modestes mais denses
et animés, s'étalaient des tracés de voies
somptuaires délimitant de nombreux terrains vagues où
se dispersaient un petit nombre d'immeubles et quelques villas".
" Inorganique, la ville n'avait ni centre, ni unité
", trop étendue elle avait de lourdes charges d'équipement
à supporter ce qui aurait freiné son développement
jusqu'en 1945.
Il fut décidé de "dimensionner"
la ville nouvelle en fonction des ressources de son "hinterland"
en permettant cette fois-ci une "extension raisonnable"
(Mas)
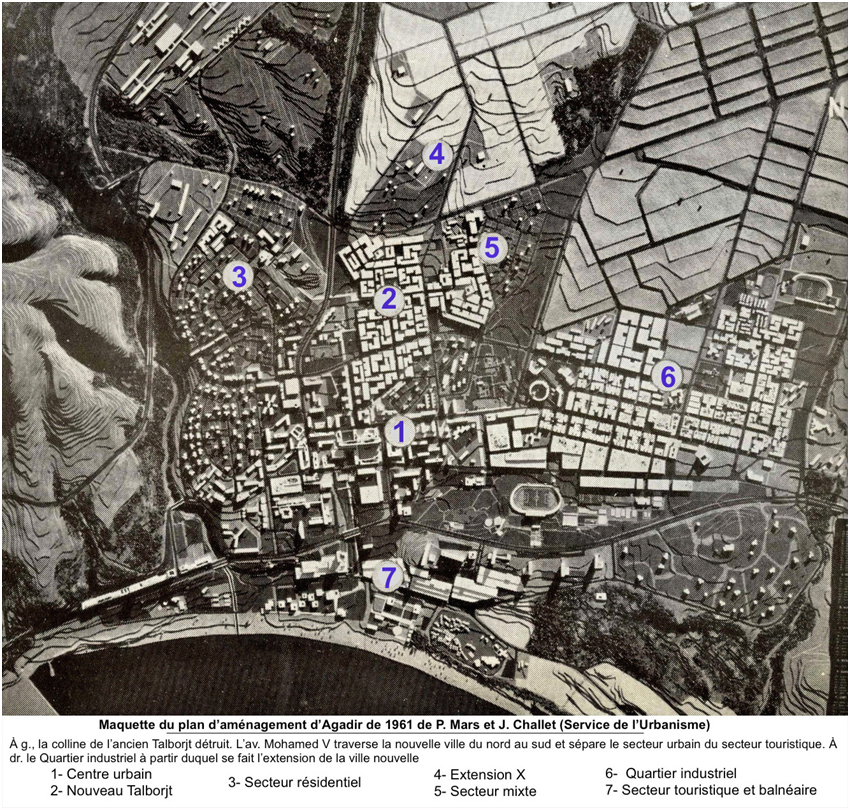
| Options du Plan directeur |
Il fut conçu en fonction de 3 fonctions "vitales"
reconnues à la ville :
1- Une fonction administrative :
Agadir, au moment du séisme, constituait le Chef-lieu
d'une vaste province de 53 000 km2 qui constituait une zone économique
du royaume, bien individualisée et isolée sur le
plan géographique (Mas a+u 4 p 6).
La ville et sa région disposait d'infrastructures
importantes :
1. Un port dont le trafic progressait régulièrement,
2. Un aérodrome prêt à recevoir des
moyens courriers à réaction,
3. Agadir était aussi un point de passage routier obligé
: tous les produits locaux y affluaient, tous les produits importés
y passaient.
La ville disposait de bâtiments administratifs dont
l'Hôtel de Ville, le Tribunal d'Instance
et la Sécurité régionale qui avaient
résisté au séisme et pouvaient être
remis en état.
2- Une fonction commerciale et industrielle :
Agadir drainait toute l'économie de la région
(agriculture, pêche et tourisme). Il s'agissait d'une zone
économique prometteuse sur le plan agricole et à
l'exportation, et des produits de la mer encore peu exploités
même si l'industrie de la conserve traversait une crise
due aux difficultés de commercialisation (en dehors de
la farine et engrais de poisson susceptibles de procurer à
la pêche locale de nouveaux débouchés) ;
les ressources minières semblaient moins importantes que
prévu. Parmi les industries, Agadir disposait d'une cimenterie
fabriquant un excellent liant et d'une minoterie.
Le commerce de gros et de demi-gros groupé à l'ancien
Talborjt avant le séisme drainait la production agricole
et les importations ; la ville devait rester un lieu d'échange
et de développement d'activités diverses ;
3- Une fonction touristique :
En raison de son climat exceptionnel et de sa très
belle baie et de sa plage magnifique, il fut décidé
de réserver aux hôtels et aux établissements
balnéaires un vaste secteur boisé en contact direct
avec la plage (P. Mas, 10). Agadir représentait un relais
pour visiter et découvrir le Sud marocain (Taroudant,
Tafraout, Goulimine, Anti-Atlas, Vallée du Paradis, Ida
Ou Tanane, etc.). Toutes les conditions devaient permettre à
Agadir d'assurer la 1ère place dans l'équipement
touristique du Royaume (Mas, 10).
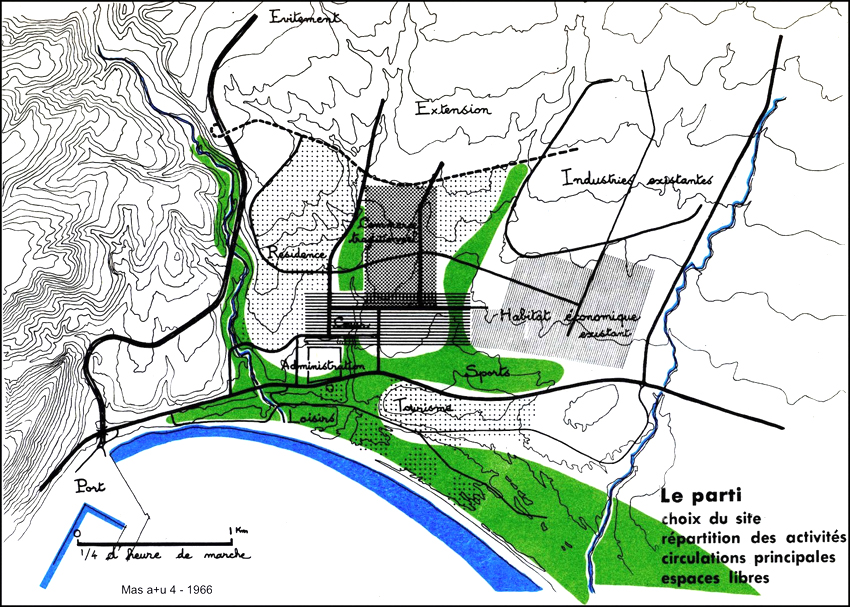
Dans un 1er temps, une "ville provisoire"
fut créée pour abriter les sinistrés pendant
la période de reconstruction.
Plusieurs cités provisoires furent aménagées
autour de la cité ouvrière du Quartier Industriel
Sud et à Anza sur des terrains non immédiatement
utilisables.
Il fut nécessaire de déterminer très rapidement
avant que les plans d'aménagement soient terminés,
l'emplacement réservé aux édifices publics
comme l'Hôpital provincial.
Il s'agissait de revoir tout ce qui touchait à l'assainissement,
les réseaux divers, la voierie et régler certains
problèmes liés à la topographie pour remodeler
la ville avant de commencer la reconstruction (exemple de l'oued
Tanout qui coupait la ville en 2).
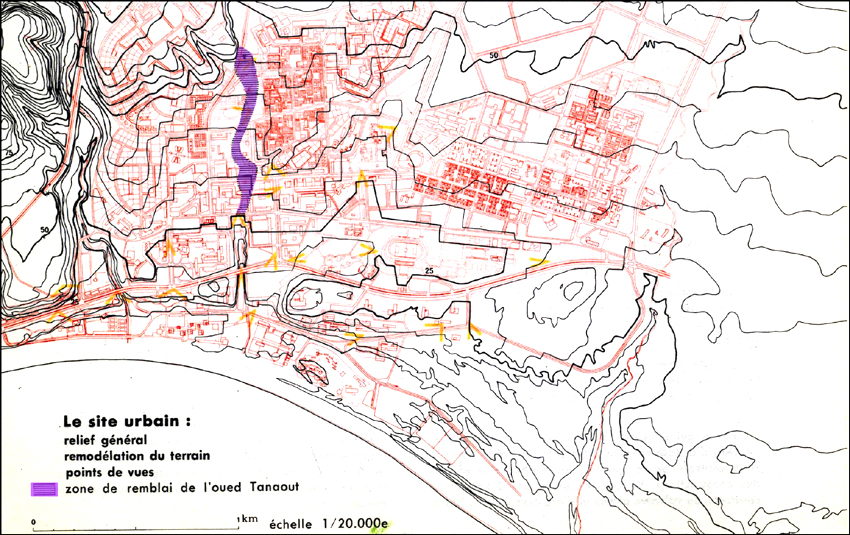

| Les principes suivants
furent adoptés : |
1. Permettre le développement des activités
industrielles et touristiques : En raison de ces 2 activités
jugées incompatibles (tourisme et industrie), la zone
des Dunes et les terrains situés entre la RP8 et la plage,
furent réservés aux activités touristiques
et balnéaires pour offrir une zone de développement
en profondeur disposant de vues sur la baie grâce à
un dénivelé de 15 m. Cette zone devait restée
en contact étroit avec la ville. Le secteur touristique
fut isolé des quartiers industriels par la création
d'une voie d'évitement, libérant les circulations
urbaines du trafic des poids lourds assurant une liaison directe
entre le port et le QI Sud ;
2. Créer un nouveau "cœur"
de ville, au carrefour des activités essentielles
;
3. Priorité fut donnée à la renaissance
du secteur de commerce traditionnel en intégrant le
"Nouveau Talborjt" au nouveau "cœur"
de la ville ;
4. Regrouper tous les services administratifs et provinciaux,
les services des TP et ceux du Tribunal administratif auparavant
dispersés, au sein d'une Cité administrative
unique ;
5. Assurer le meilleur développement possible
des secteurs résidentiels périphériques
;
6. Établir un plan clair sur une
trame orthogonale avec des construction sur les points
hauts, les points bas et thalwegs étant réservés
aux jardins publics, boisements et terrains de sports (Mas, 11).
Une importance particulière était accordée
à l'aménagement d'"espaces libres publics",
jardins, boisements, places pour faire d'Agadir une ville
pour les piétons. Ces éléments étaient
reconnus nécessaires au développement des relations
de la vie sociale dans la cité (P. Mas).

Le plan d'aménagement devait s'inscrire sur
une trame orthogonale : les voies seraient moins larges que celles
de l'ancien plan d'Agadir d'avant le séisme, le gain de
place serait utilisé pour implanter des parcs de stationnement.
Une voie d'évitement fut conçue pour libérer
les circulations urbaines du trafic des poids lourds et assurer
une liaison directe entre le port et le QI Sud.
La route principale N°8 fut déviée vers
l'Ouest pour éviter Anza et constituer une nouvelle
entrée dans la ville offrant une belle vue sur la baie.
Première conséquence de la centralisation de
la reconstitution : Agadir fut la 1ère ville marocaine
à bénéficier d'un SDAU (Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme) et d'un PLHDU (Plan Local
d'Habitat et de Développement Urbain).

- Mas P. : Plan directeur et plans d'aménagement
(a+u, pp. 6-17, 1966)
- Beurret C. : Architecture et aménagements publics
(a+u, pp. 34-35, 1966)
- Péré M. : Agadir, ville nouvelle, Revue
de Géographie du Maroc, n°12, 1967
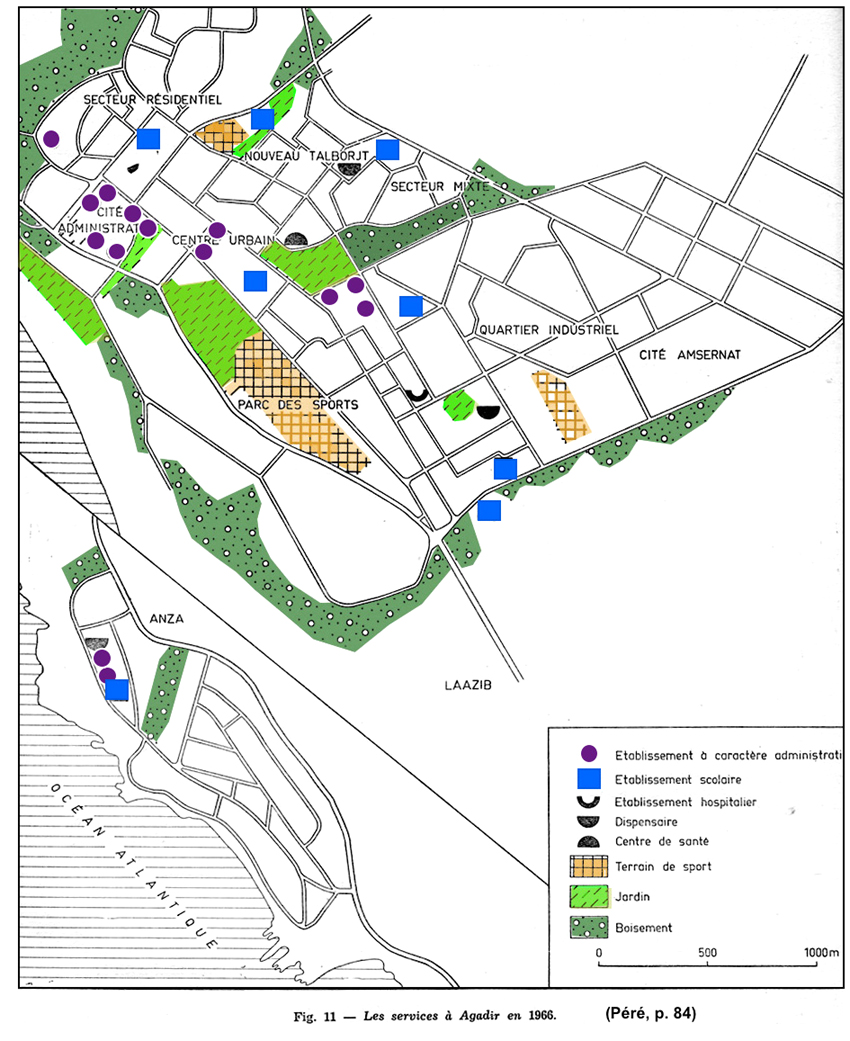
|