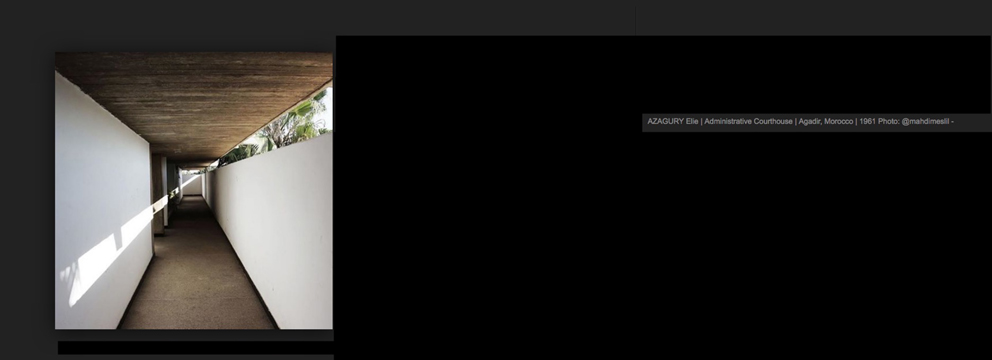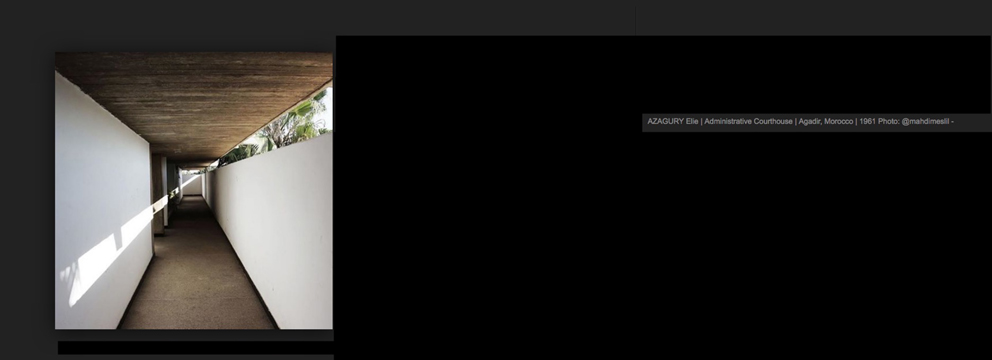|
Les influences essentielles qui ont marqué ses études
et sa carrière proviennent selon lui d'Auguste Perret
mais surtout de Le Corbusier et du groupe des CIAM
dont il fit partie jusqu'à sa dissolution. Il sera
pénétré de la science des matériaux
et de la légèreté de l'architecture nordique
au contact de Ralph Erskine (Cohen, 419).
Il eut durant toute sa carrière des contacts étroits
et durables avec des architectes tels que José Louis
Sert, Paul Nelson, Richard Neutra, Oscar Niemeyer, Rogers et
Ralph Erskine.
En 1949, il ouvre sa propre agence à Casablanca (située
dans le quartier résidentiel d'Anfa) dans laquelle il
restera en activité jusqu'en 2007.
Il réalise de nombreuses villas à Casablanca
dont la célèbre villa Schulman (1951) d'un
"fonctionnalisme organique et inventif" et sa maison
personnelle en 1962 d'un "néo-brutalisme manifeste"
(Arch. Française d'O-M, 383).

 |
Il fut membre de l'Union des Artistes Modernes et des
CIAM, membre du GAMMA du groupe CIAM-Maroc, membre du Cercle
d'Études Architecturales de Paris.
Il fut très impliqué dans les CIAM lors des
débats sur l'urbanisme.
Il participa à la revue "Carré Bleu".
Les années 50 connaissent une grande réflexion
sur l'urbanisme et le logement social avec le concept d'"Habitat
pour le plus grand nombre".
Azagury participe à ce mouvement.
Il conçoit le quartier d'habitations populaires du Derb
El Jdid (1957-1960).
|
À la fin des années 50, sa seconde maison et
son agence à Anfa constituent "l'un des manifestes
les plus achevés du néo-brutalisme corbuséen"
(AF O-M, 383).
Adepte du métissage, il accomplit de nombreux voyages
d'étude et aime mélanger les styles.
Après l'Indépendance du Maroc, il devient le
1er président de l'Ordre des Architectes du Maroc. Membre
de l'UAM. Il fonde le groupe Quadra avec Omar Alaoui.
Son œuvre est considérable après l'indépendance.
Il conçoit des groupes scolaires (Groupe scolaire Longchamp
avec l'architecte J. Lévy, AA 60, juin 1955, p.
68), l'Office du Thé à Casablanca avec Henri
Tastemain en 1956 et des ensembles d'habitat économique
ou populaire, des bâtiments pour le complexe touristique
de Cabo Negro en 1968.
|
Il participe activement à la Reconstruction d'Agadir
Il conçoit :
Le Tribunal et la Cité administrative d'Agadir au début
des années 60 ;
La Banque Al Maghrib en 1997.

|
 |
 |
Il concevra avec l'architecte François Lemarié,
l'Hôpital Hassan II (ouverture de chantier en 1962)
;

|
Selon l'architecte Driss Kettani, Élie Azagury
fut un des derniers représentants de ces pionniers qui
avaient l'architecture au cœur et avaient donné ses
lettres de noblesse à l'architecture marocaine du XXème
siècle.
Cette architecture se caractérise par une rigueur structurelle,
une puissance plastique, l'authenticité des matériaux
et une touche de baroque ; une architecture moderne authentiquement
marocaine.
Élie Azagury disait :
"Il me semble indispensable lorsque les idées
neuves viennent en surface, de les exprimer avec la plus grande
force possible.
L'esprit de caricature ou de brutalité ne me dérange
pas, les années à venir adoucissent les formes
et, ce qui nous a semblé ou qui nous semble féroce,
devient quotidien".
"Mon travail à Agadir, dira-t-il, s'est fait
dans un climat d'enthousiasme et de fraicheur, j'étais
jeune, sur de moi, passionné et bouleversé par
la terrible catastrophe dans laquelle venaient de périr
20 000 personnes.
La collaboration a été parfaite, des liens profonds
d'amitié se sont créés entre nous et durent
encore aujourd'hui. La réalisation d'une pareille tâche
reste pour moi un exemple…"
|
"Aujourd'hui, constatait-il, l'architecture
moderne fait partie du paysage marocain et constitue un patrimoine
important.
Malheureusement ce patrimoine moderne ne suscite aucun
intérêt.
Mais en dehors de sa qualité architecturale et de sa valeur
esthétique, cette architecture doit faire partie de ce
patrimoine pour deux raisons :
Cette architecture est exceptionnelle et porteuse d'un message
social et d'une grande ambition marocaine.
Elle est spécifique à une époque et raconte
l'histoire du Maroc moderne".
|
Il disait que cette architecture (en dehors
de sa qualité architecturale et sa valeur esthétique)
devait faire partie du patrimoine pour les deux raisons énoncées
: le message social et l'histoire du Maroc.
Pour Azagury, les pouvoirs publics ont le devoir de préserver
cette mémoire, qui est la seule référence
historique spatiale et culturelle de la ville d'Agadir après
sa démolition totale. Malheureusement, disait-il, ces
bâtiments sont laissés à l'abandon et souvent
défigurés.
Plus tardivement, Élie Azagury sera plus acerbe et critiquera
le plan d'urbanisme, estimant en 2007 que l'occasion est venue
de reprendre le plan dans un esprit et une vision nouvelle. Il
jugera que celui ci tourne le dos à la mer, s'étale
sur une trop grande surface, que les équipements sont
trop éparpillés. "On ne peut pas se promener
à Agadir" répétait-il avec véhémence. |
Il ajoutait :
"Le résultat n'est pas brillant…
Il est vrai que les architectes qui ont participé à
sa reconstruction ont réalisé certains bâtiments
de bonne qualité mais l'urbanisme de la ville laisse beaucoup
à désirer. Sans m'étendre, je dirai que
l'on a fait d'une ville en bord de mer une ville de l'intérieur.
Le schéma directeur, très ambitieux, n'est pas
arrivé et arrivera difficilement à lier les composantes
de la ville. Après trente années d'existence, Agadir
présente des espaces indéfinis "des no man's
land" extrêmement difficiles à combler, il
est impossible d'y circuler à pied, sauf si l'on reste
dans un quartier, sur la plage ou dans un hôtel. Le centre
est décousu et s'étire difficilement, les vides
entre les hôtels sont désespérants, la mer
est inaccessible sauf pour quelques formations hôtelières
construites sur le littoral… Toutes ces erreurs peuvent
s'admettre lorsqu'il s'agit d'une ville de 2 ou 3 millions d'habitants
mais restent inexcusables dans le cas d'Agadir".
(Avril 2007, Rencontre d'architectes à Agadir lors de
ma mise en place d'Archimedia)
|
Il est mort à 91 ans à Casablanca.
- Sources Cohen, p. 461,
- Association de sauvegarde du patrimoine architectural du
XXème siècle au Maroc- Newsletter n°10, mars
2010,
- Architectures françaises Outre-Mer, notice biographique,
p. 383.
- Témoignage de Driss Kettani à la mort d'Élie
Azagury.
|